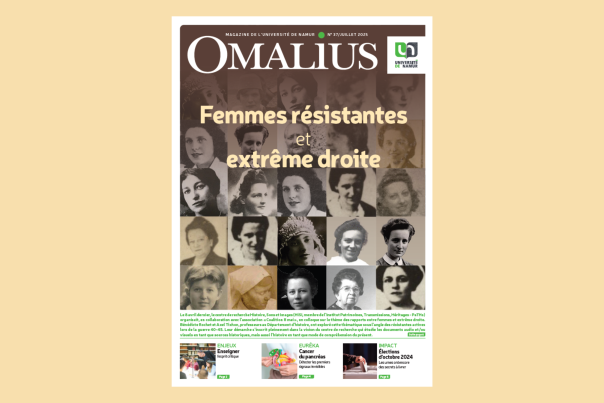En parallèle des stages de trois jours, le CRO propose également une autre formule, plus poussée : l’internat d’agnelage. Ce programme de huit à neuf jours permet de vivre au rythme de la ferme et d’assurer la coordination des stagiaires ainsi que la supervision des soins en dehors des heures de présence du personnel. « Cette immersion offre aux étudiants une opportunité unique d’acquérir des connaissances approfondies et des compétences opérationnelles essentielles à la gestion des parturitions et des premières étapes de la vie du nouveau-né (néonatologie) », explique Astrid Petit.
Avant de commencer, les internes bénéficient d’une formation théorique et d’un entraînement clinique. Ils apprennent à repérer certaines pathologies (métrites, rétentions, mammites...), à intervenir lors de complications obstétricales, à pratiquer certains gestes médicaux autorisés sous supervision (prise de sang, injection, pose d’une sonde, réanimation néonatale…) et à assurer un suivi attentif des brebis et des agneaux.
« Ce qui nous manque lors des études c’est le contact avec l’animal, surtout l’animal vivant. Pouvoir être sur place et appliquer des informations théoriques que l’on a reçues en cours, c’est vraiment une opportunité incroyable », témoigne Chloé, étudiante en troisième année. « Ici, on est aussi encadré par des professionnels de l’Université et par des vétérinaires. Ils sont là pour nous aider et nous apporter des informations supplémentaires, tout en nous laissant une très grande autonomie. Le fait de se retrouver entre stagiaires et internes crée une vraie dynamique d’apprentissage, avec des échanges très riches », conclut-elle.