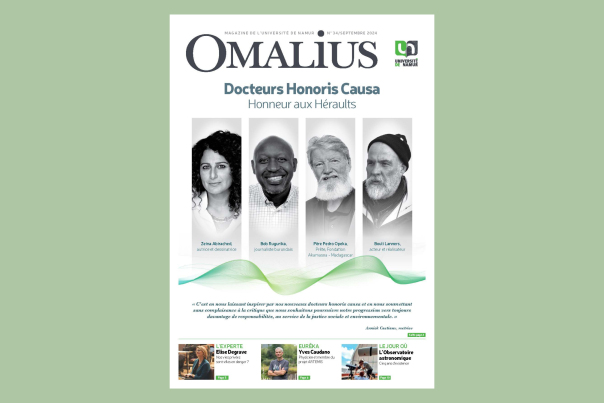Lorsque le virus pénètre dans l’une de nos cellules, il y déverse son ARN. « La cellule dispose alors d'outils, des enzymes capables d'induire des mutations dans ce génome viral, afin de le rendre inopérant et ainsi ralentir le développement de l'infection », précise le chercheur. « Nous travaillons sur ces enzymes, depuis plusieurs années, via d'autres virus plus courants, comme les adénovirus. Mais nous avons la chance, à l'UNamur, d'avoir un laboratoire de catégorie 3 qui nous permet de travailler sur le SARS-CoV-2 et d'élargir nos compétences. »
Ces recherches ont aussi pour objectif de mieux comprendre cette étrange pathologie qu'est le Covid long. En effet, un nombre important de personnes ayant contracté le Covid-19 continuent de souffrir de symptômes divers, tels qu'une fatigue importante, des difficultés respiratoires, ou encore des symptômes neurologiques comme un brouillard mental et des douleurs.
Très tôt, les chercheurs de l'UNamur, Nicolas Gillet et Charles Nicaise, professeur au Département de médecine et président de l’Institut NARILIS, ont collaboré sur ce sujet pour mieux en comprendre les causes, notamment au niveau du cerveau. « Il existe plusieurs hypothèses à ce sujet. Compte tenu de la variabilité des symptômes de la maladie, il s'agit très certainement d'un phénomène multifactoriel », pense Charles Nicaise. « Pour notre part, nous avons choisi de nous concentrer sur les aspects auto-immuns de la maladie. »
L'hypothèse envisagée par le chercheur, et confirmée par les premiers résultats, implique des anticorps des malades dirigés, non pas contre le virus, mais contre ses propres cellules.