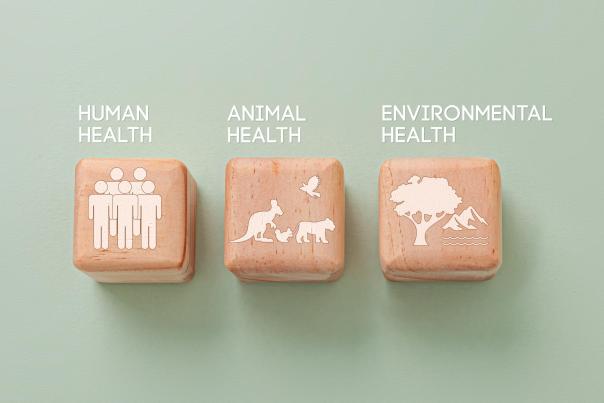Le 22 mai prochain, la Faculté de droit de l’UNamur organise, en collaboration avec la Faculté de médecine, un colloque sur la thématique « Droit et hôpital », deux mondes qui se connaissent assez mal et communiquent assez peu, alors qu’ils comptent de nombreuses intersections... « Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait une réelle difficulté à faire entrer en relation les préoccupations de terrain et les préoccupations plus juridiques », explique Charlotte Lambert, juriste à la Faculté de droit de l’UNamur et initiatrice de ce colloque. « Avec des effets pervers comme le fait que certains praticiens vont avoir tendance à pratiquer beaucoup d’examens pour être sûrs de ne pas passer à côté d’une pathologie, sous peine d’être poursuivis judiciairement... Et du côté juridique, une certaine difficulté à se rendre compte de tout ce qu’implique une pratique hospitalière. » Pour Florence George, professeure à la Faculté de droit de l’UNamur, membre de l’Institut NaDI (Namur Digital Institute) et coorganisatrice du colloque, « l’idée, c’est de sortir de sa tour d’ivoire et d’aller voir les questions qui se posent concrètement sur le terrain ». Avec comme mot d’ordre : l’interdisciplinarité au carré ! « Nous voulions un sujet fédérateur, non seulement capable de faire dialoguer toutes les disciplines juridiques, mais pour lequel chaque thématique pourrait être travaillée par un binôme composé d’un juriste et d’un non-juriste », détaille Pauline Colson, chargée de cours à la Faculté de droit de l’UNamur, également coorganisatrice de l’événement.
Tous patients
Parmi les enjeux qui seront abordés : l’intelligence artificielle, la cybercriminalité, le bien-être au travail, la liberté de conscience du médecin, les enjeux autour du triage des patients ou encore les questions soulevées par le RGPD (Règlement Général de Protection des Données). « La question est de savoir si le RGPD, tel qu’on devrait l’appliquer, n'aura pas aussi pour conséquence de réduire les droits du patient ou de ses enfants », illustre Florence George. « Prenons le cas d’une personne atteinte d’une maladie grave et transmissible : selon le RGPD, on ne peut conserver ses données qu’un temps maximum. Mais est-ce que ses enfants n’ont pas aussi un droit légitime de pouvoir obtenir ces informations qui pourraient avoir une répercussion sur leur propre santé ou la santé de leurs enfants ? » Un exemple qui montre que les enjeux juridiques liés à la santé ne concernent pas les seuls juristes et médecins, mais chaque citoyen... qui sera patient un jour. « Comment garantir le droit à la santé d’un point de vue géographique ? Financier ? Qu’est-ce que ce droit suppose dans le chef de l’État belge ? » interrogent les coordinatrices du projet. « Il existe de nombreux enjeux sociétaux autour du droit à la santé... »