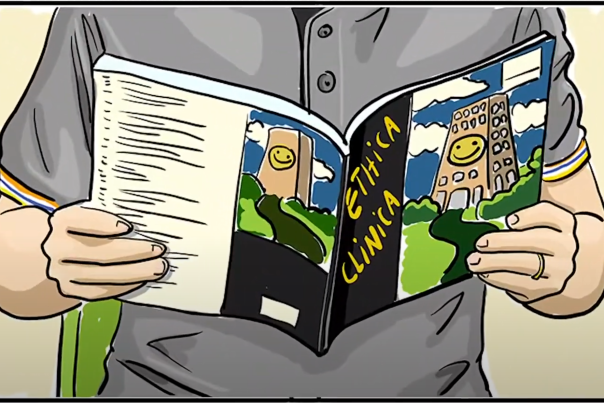Département de philosophie au sein de la Faculté des sciences, cette entité développe des réflexions sur les enjeux épistémologiques, éthiques, sociaux, politiques et culturels des sciences et des techniques.
Les enseignements portés par les membres du département sont principalement dispensés en facultés des sciences et de médecine et portent sur la philosophie des sciences, l’épistémologie, la logique, la philosophie de la médecine, la bioéthique ou encore l’éthique sociale et politique. L’objectif est d’initier les étudiants et étudiantes à développer une réflexion critique sur leur discipline scientifique et sur les rapports entre sciences et sociétés.
Les 4 axes autour de l'enseignement et de la recherche
1. Philosophie des sciences
2. Éthique des soins de santé
3. Développement humain, justice sociale, interculturalité
4. Philosophie de la médecine
En savoir plus sur le Département sciences, philosophie et sociétés
À la une
Actualités

« Par-delà les gènes » : et si on repensait la notion d’hérédité ?
« Par-delà les gènes » : et si on repensait la notion d’hérédité ?
Sommes-nous prisonniers de notre patrimoine génétique ? La filiation se réduit-elle uniquement aux gènes ? Peut-on échapper à son destin ? Des questions existentielles que nous nous posons tous et auxquelles Gaëlle Pontarotti, chargée de cours et chercheuse au Département Sciences, philosophies et sociétés de l’UNamur, apporte un éclairage inédit dans son livre Par-delà les gènes. Une autre histoire de l’hérédité, paru en octobre dernier aux éditions Gallimard.

Jusqu’à la fin du XXe siècle, l’hérédité était envisagée par les scientifiques comme une affaire de gènes et de transmission d’ADN. Mais depuis quelques décennies, des travaux révèlent des transmissions non-génétiques, contribuant à expliquer pourquoi les enfants ressemblent en moyenne davantage à leurs parents qu’à d’autres individus d’une population. Parmi celles-ci : des transmissions épigénétiques (modifications de l’activité des gènes sans changer la séquence d’ADN), microbiennes, hormonales ou encore comportementales. Certains biologistes et philosophes parlent désormais d’« hérédité étendue ».
Entre fatalisme et liberté
« L’enjeu est de redessiner le concept d’hérédité, en dépassant la vision strictement génétique qui prévalait jusque-là », explique Gaëlle Pontarotti. « L’objectif de mon livre et de mes recherches est d’articuler différentes formes de transmission et de repenser la compatibilité entre hérédité et liberté transgénérationnelle ».
Car depuis l’Antiquité grecque, tout laisse à penser que nous sommes enfermés dans un destin familial. Mais si l’hérédité dépasse les gènes, quelle est notre marge de manœuvre ? « Tout l’enjeu est de trouver un juste milieu entre fatalisme héréditaire et illusion de toute-puissance face à notre héritage », résume la chercheuse.
Un changement de paradigme aux conséquences multiples
Cette nouvelle conception bouscule notre vision de la filiation et du statut de l’individu. Nous ne sommes plus seulement des objets déterminés par des causes qui nous dépassent : nous redevenons acteurs de ce que nous recevons et transmettons. Elle invite aussi à reconsidérer la place des gènes dans la filiation : le parent est-il fondamentalement celui qui transmet son patrimoine génétique ?
Et si, finalement, notre héritage était aussi ce que nous choisissions d’en faire ?
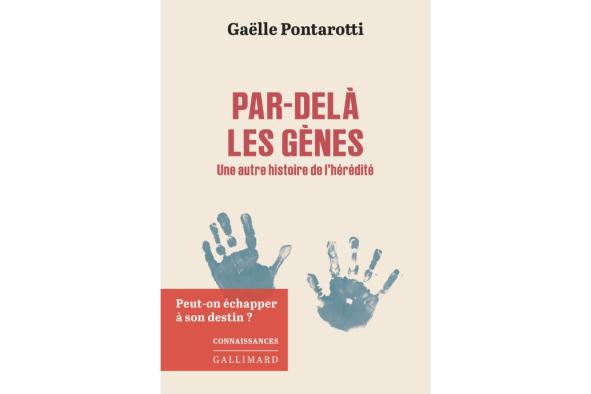
Crédit couverture : Éditions Gallimard, visuel de l’ouvrage Par-delà les gènes.
Découvrir le livre
Par-delà les gènes. Une autre histoire de l'hérédité, de Gaëlle Pontarotti — Gallimard (collection Connaissances)

L’UNamur en Amérique du Sud
L’UNamur en Amérique du Sud
L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.
L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert
Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »
Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.
Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation
Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.
Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.
C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.
Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »
Retour d’expérience d'une étudiante
« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.
Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.
Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »
- Thaïs Nivaille, étudiante en physique
Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


SPiN : un nouveau centre de recherche pour penser les sciences autrement
SPiN : un nouveau centre de recherche pour penser les sciences autrement
À l’heure où la désinformation, la post-vérité et le complotisme fragilisent la confiance dans les sciences, l’UNamur accueille SPiN (Science & Philosophy in Namur), un nouveau centre de recherche interdisciplinaire qui interroge la place des sciences dans la société. Fondé en septembre dernier par Olivier Sartenaer, professeur de philosophie des sciences à l’UNamur, SPiN rassemble des philosophes et des scientifiques autour d’une vision commune : développer une réflexion critique et accessible sur les sciences dans toute leur diversité.

De gauche à droite : Doan Vu Duc, Maxime Hilbert, Charly Mobers, Olivier Sartenaer, Louis Halflants, Andrea Roselli, Gauvain Leconte-Chevillard, Eve-Aline Dubois.
Si l’UNamur se distingue par la présence d’un département de philosophie des sciences au sein de sa Faculté des sciences, aucun centre de recherche n’était jusqu’ici spécifiquement dédié aux enjeux épistémologiques, éthiques, politiques et métaphysiques des sciences. SPiN vient combler ce vide.

« Plusieurs facteurs contingents ont permis la création de SPiN : l’absence d’une structure de recherche spécifiquement dédiée à ces thématiques et l’arrivée quasiment simultanée de quatre jeunes philosophes des sciences. C’est un peu un alignement des planètes », explique Olivier Sartenaer.
A ses côtés, on retrouve Juliette Ferry-Danini (Faculté d’informatique), Thibaut De Meyer (Faculté de philosophie et lettres) et Gaëlle Pontarotti (Faculté des sciences), qui forment le noyau dur de SPiN.
Répondre à une demande sociétale forte
SPiN s’inscrit dans une dynamique de recherche engagée au cœur des débat contemporains.

On ressent un réel besoin d’éclairage des citoyens sur ces questions. C’était important pour nous qu’une structure de recherche reflète cette demande sociétale grandissante et accueille des recherches sur ces thématiques.
Les chercheurs de SPiN explorent un large éventail de thématiques, avec en toile de fond une interrogation sur notre rapport à la connaissance scientifique. Parmi ceux-ci :
- le rapport entre sciences et pseudosciences ;
- le réductionnisme dans les sciences ;
- le déterminisme génétique et l’hérédité ;
- l’éthique médicale et la santé publique (vaccinations, pandémies) ;
- l’éthologie,
- le perspectivisme.
Ces recherches sont portées par une équipe interdisciplinaire composée d’enseignants-chercheurs, de doctorants et de postdoctorants issus des différentes facultés de l’UNamur.
Un lieu de rencontre académique…mais aussi citoyen
SPiN organise des séminaires hebdomadaires consacrés aux recherches en cours en philosophie des sciences ainsi que des séminaires liés à des thématiques plus spécifiques : la santé, les sciences du vivant, la cosmologie et les théories de l’émergence et du réductionnisme dans les sciences naturelles.
Mais SPiN ne se limite pas à la sphère académique : le centre entend faire sortir ces questions hors des murs de l’université, au travers d’événements et d’activités accessibles à toutes et tous. Un événement inaugural est d’ores et déjà planifié pour le printemps prochain sur une thématique d’actualité : la méfiance dans les sciences. Plus d’infos à venir !
En savoir plus sur le centre de recherche SPiN

Une mission exploratoire pour tisser des liens avec le Sénégal
Une mission exploratoire pour tisser des liens avec le Sénégal
Une délégation de l’Université de Namur a participé à une mission exploratoire à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, au Sénégal. L’objectif : découvrir les recherches menées sur le terrain, rencontrer les chercheurs de l’UCAD et initier de futures collaborations entre les deux institutions.

Dix membres du corps académique et scientifique de l’UNamur, accompagnés par le Service des relations internationales et de l’ONG FUCID, le Forum Universitaire pour la Coopération Internationale au Développement, ont participé à une mission exploratoire co-organisée avec l’UCAD. Cette mission s’inscrivait dans la volonté de l’université de renforcer les partenariats avec le Sud, en favorisant les échanges, en sensibilisant les chercheurs aux enjeux du Sud global et en faisant émerger de nouveaux projets.
Pendant une semaine, plusieurs activités ont été organisées pour permettre aux membres de la délégation de découvrir l’université sénégalaise : visite de l’UCAD et découverte de ses enjeux, échanges autour du concept « One Health », rencontres entre chercheurs, visite de terrain et moment de clôture en présence de partenaires institutionnels.
Catherine Linard, professeure à la Faculté des sciences, faisait partie de la délégation namuroise « Se rendre sur place et échanger avec nos collègues sénégalais est très important. Cela nous permet de découvrir la richesse de leurs recherches, dans des domaines souvent directement connectés aux réalités du terrain », explique-t-elle.
Depuis 2015, Catherine Linard collabore avec l’UCAD, notamment dans le cadre d’un projet de recherche et développement soutenu par l’ARES. « De cette première collaboration sont nées de nombreuses dynamiques. Plusieurs doctorants sénégalais sont venus en Belgique pour poursuivre leurs recherches. Et inversement, une de mes doctorante belge, Camille Morlighem, qui travaille sur la création de cartes de risque de malaria au Sénégal, a pu bénéficier de bourses de mobilité pour des séjours de recherche à l’UCAD. Nous avons également établi des échanges d’enseignement : je me suis rendue à Dakar pour donner une semaine de formation aux doctorants en géographie, et une collègue géographe de la santé, Aminata Niang Diène, vient chaque année en Belgique pour intervenir dans un de mes cours de master », poursuit la professeure.
Les participants
La délégation rassemblait des profils issus de plusieurs facultés de l’UNamur et de services :
- Francesca Cecchet, Faculté des sciences, présidente de l’Institut de recherche NISM (Namur Institute of Structured Matter) et membre de l’Institut de recherche (NaRILIS Namur Research Institute for Life Sciences)
- Laurent Houssiau, Faculté des sciences et membre de l’Institut de recherche NISM (Namur Institute of Structured Matter)
- Charles Nicaise, Faculté de médecine et président de l’Institut de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences)
- Denis Saint-Amand, Faculté de philosophie et de lettres et membre de l’Institut de recherche NaLTT (Namur Institute of Language, Text and Transmediality)
- Laurent Ravez, Facultés de médecine et des sciences et membre des Instituts de recherche NaRILiS (Namur Research Institute for Life Sciences) et EsPhiN (Espace Philosophique de Namur)
- Anne Vermeyen, membre de la Cellule bien-être animal
- Flora Musuamba, Faculté de médecine et membre de l’Institut de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences)
- Florence Georges, Faculté de droit et membre de l’Institut de recherche NaDI (Namur Digital Institute)
- Nathanaël Laurent, Faculté des sciences et membre de l’Institut de recherche EsPhiN (Espace Philosophique de Namur)
- Catherine Linard, Faculté des sciences et membre des Instituts de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences) et ILEE (Institute of Life-Earth-Environment)
- Rita Rixen, directrice de la FUCID, le Forum universitaire pour la coopération internationale au développement
- Amélie Schnock, membre du Service des relations internationales
L’Université de Namur à l’international
Engagée dans la coopération internationale et au développement, l’Université de Namur entretient de nombreuses collaborations avec plusieurs institutions dans le monde entier. Ces collaborations se réalisent à travers des projets de recherche, des missions d’enseignement ou de formation, ou encore des formations d'étudiants dans le cadre de l'offre d'enseignement de l'UNamur ou dans le cadre de stages de courte durée, notamment de recherche.

« Par-delà les gènes » : et si on repensait la notion d’hérédité ?
« Par-delà les gènes » : et si on repensait la notion d’hérédité ?
Sommes-nous prisonniers de notre patrimoine génétique ? La filiation se réduit-elle uniquement aux gènes ? Peut-on échapper à son destin ? Des questions existentielles que nous nous posons tous et auxquelles Gaëlle Pontarotti, chargée de cours et chercheuse au Département Sciences, philosophies et sociétés de l’UNamur, apporte un éclairage inédit dans son livre Par-delà les gènes. Une autre histoire de l’hérédité, paru en octobre dernier aux éditions Gallimard.

Jusqu’à la fin du XXe siècle, l’hérédité était envisagée par les scientifiques comme une affaire de gènes et de transmission d’ADN. Mais depuis quelques décennies, des travaux révèlent des transmissions non-génétiques, contribuant à expliquer pourquoi les enfants ressemblent en moyenne davantage à leurs parents qu’à d’autres individus d’une population. Parmi celles-ci : des transmissions épigénétiques (modifications de l’activité des gènes sans changer la séquence d’ADN), microbiennes, hormonales ou encore comportementales. Certains biologistes et philosophes parlent désormais d’« hérédité étendue ».
Entre fatalisme et liberté
« L’enjeu est de redessiner le concept d’hérédité, en dépassant la vision strictement génétique qui prévalait jusque-là », explique Gaëlle Pontarotti. « L’objectif de mon livre et de mes recherches est d’articuler différentes formes de transmission et de repenser la compatibilité entre hérédité et liberté transgénérationnelle ».
Car depuis l’Antiquité grecque, tout laisse à penser que nous sommes enfermés dans un destin familial. Mais si l’hérédité dépasse les gènes, quelle est notre marge de manœuvre ? « Tout l’enjeu est de trouver un juste milieu entre fatalisme héréditaire et illusion de toute-puissance face à notre héritage », résume la chercheuse.
Un changement de paradigme aux conséquences multiples
Cette nouvelle conception bouscule notre vision de la filiation et du statut de l’individu. Nous ne sommes plus seulement des objets déterminés par des causes qui nous dépassent : nous redevenons acteurs de ce que nous recevons et transmettons. Elle invite aussi à reconsidérer la place des gènes dans la filiation : le parent est-il fondamentalement celui qui transmet son patrimoine génétique ?
Et si, finalement, notre héritage était aussi ce que nous choisissions d’en faire ?
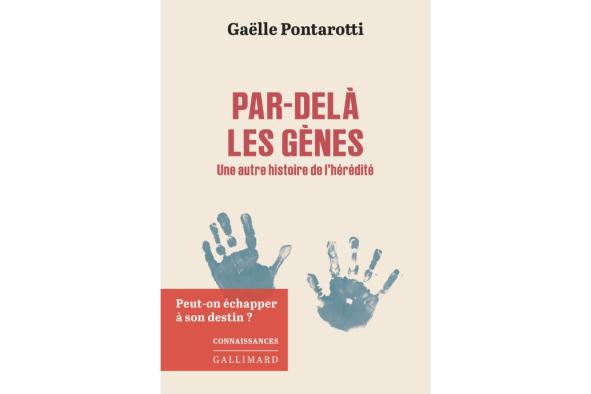
Crédit couverture : Éditions Gallimard, visuel de l’ouvrage Par-delà les gènes.
Découvrir le livre
Par-delà les gènes. Une autre histoire de l'hérédité, de Gaëlle Pontarotti — Gallimard (collection Connaissances)

L’UNamur en Amérique du Sud
L’UNamur en Amérique du Sud
L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.
L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert
Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »
Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.
Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation
Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.
Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.
C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.
Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »
Retour d’expérience d'une étudiante
« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.
Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.
Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »
- Thaïs Nivaille, étudiante en physique
Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


SPiN : un nouveau centre de recherche pour penser les sciences autrement
SPiN : un nouveau centre de recherche pour penser les sciences autrement
À l’heure où la désinformation, la post-vérité et le complotisme fragilisent la confiance dans les sciences, l’UNamur accueille SPiN (Science & Philosophy in Namur), un nouveau centre de recherche interdisciplinaire qui interroge la place des sciences dans la société. Fondé en septembre dernier par Olivier Sartenaer, professeur de philosophie des sciences à l’UNamur, SPiN rassemble des philosophes et des scientifiques autour d’une vision commune : développer une réflexion critique et accessible sur les sciences dans toute leur diversité.

De gauche à droite : Doan Vu Duc, Maxime Hilbert, Charly Mobers, Olivier Sartenaer, Louis Halflants, Andrea Roselli, Gauvain Leconte-Chevillard, Eve-Aline Dubois.
Si l’UNamur se distingue par la présence d’un département de philosophie des sciences au sein de sa Faculté des sciences, aucun centre de recherche n’était jusqu’ici spécifiquement dédié aux enjeux épistémologiques, éthiques, politiques et métaphysiques des sciences. SPiN vient combler ce vide.

« Plusieurs facteurs contingents ont permis la création de SPiN : l’absence d’une structure de recherche spécifiquement dédiée à ces thématiques et l’arrivée quasiment simultanée de quatre jeunes philosophes des sciences. C’est un peu un alignement des planètes », explique Olivier Sartenaer.
A ses côtés, on retrouve Juliette Ferry-Danini (Faculté d’informatique), Thibaut De Meyer (Faculté de philosophie et lettres) et Gaëlle Pontarotti (Faculté des sciences), qui forment le noyau dur de SPiN.
Répondre à une demande sociétale forte
SPiN s’inscrit dans une dynamique de recherche engagée au cœur des débat contemporains.

On ressent un réel besoin d’éclairage des citoyens sur ces questions. C’était important pour nous qu’une structure de recherche reflète cette demande sociétale grandissante et accueille des recherches sur ces thématiques.
Les chercheurs de SPiN explorent un large éventail de thématiques, avec en toile de fond une interrogation sur notre rapport à la connaissance scientifique. Parmi ceux-ci :
- le rapport entre sciences et pseudosciences ;
- le réductionnisme dans les sciences ;
- le déterminisme génétique et l’hérédité ;
- l’éthique médicale et la santé publique (vaccinations, pandémies) ;
- l’éthologie,
- le perspectivisme.
Ces recherches sont portées par une équipe interdisciplinaire composée d’enseignants-chercheurs, de doctorants et de postdoctorants issus des différentes facultés de l’UNamur.
Un lieu de rencontre académique…mais aussi citoyen
SPiN organise des séminaires hebdomadaires consacrés aux recherches en cours en philosophie des sciences ainsi que des séminaires liés à des thématiques plus spécifiques : la santé, les sciences du vivant, la cosmologie et les théories de l’émergence et du réductionnisme dans les sciences naturelles.
Mais SPiN ne se limite pas à la sphère académique : le centre entend faire sortir ces questions hors des murs de l’université, au travers d’événements et d’activités accessibles à toutes et tous. Un événement inaugural est d’ores et déjà planifié pour le printemps prochain sur une thématique d’actualité : la méfiance dans les sciences. Plus d’infos à venir !
En savoir plus sur le centre de recherche SPiN

Une mission exploratoire pour tisser des liens avec le Sénégal
Une mission exploratoire pour tisser des liens avec le Sénégal
Une délégation de l’Université de Namur a participé à une mission exploratoire à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, au Sénégal. L’objectif : découvrir les recherches menées sur le terrain, rencontrer les chercheurs de l’UCAD et initier de futures collaborations entre les deux institutions.

Dix membres du corps académique et scientifique de l’UNamur, accompagnés par le Service des relations internationales et de l’ONG FUCID, le Forum Universitaire pour la Coopération Internationale au Développement, ont participé à une mission exploratoire co-organisée avec l’UCAD. Cette mission s’inscrivait dans la volonté de l’université de renforcer les partenariats avec le Sud, en favorisant les échanges, en sensibilisant les chercheurs aux enjeux du Sud global et en faisant émerger de nouveaux projets.
Pendant une semaine, plusieurs activités ont été organisées pour permettre aux membres de la délégation de découvrir l’université sénégalaise : visite de l’UCAD et découverte de ses enjeux, échanges autour du concept « One Health », rencontres entre chercheurs, visite de terrain et moment de clôture en présence de partenaires institutionnels.
Catherine Linard, professeure à la Faculté des sciences, faisait partie de la délégation namuroise « Se rendre sur place et échanger avec nos collègues sénégalais est très important. Cela nous permet de découvrir la richesse de leurs recherches, dans des domaines souvent directement connectés aux réalités du terrain », explique-t-elle.
Depuis 2015, Catherine Linard collabore avec l’UCAD, notamment dans le cadre d’un projet de recherche et développement soutenu par l’ARES. « De cette première collaboration sont nées de nombreuses dynamiques. Plusieurs doctorants sénégalais sont venus en Belgique pour poursuivre leurs recherches. Et inversement, une de mes doctorante belge, Camille Morlighem, qui travaille sur la création de cartes de risque de malaria au Sénégal, a pu bénéficier de bourses de mobilité pour des séjours de recherche à l’UCAD. Nous avons également établi des échanges d’enseignement : je me suis rendue à Dakar pour donner une semaine de formation aux doctorants en géographie, et une collègue géographe de la santé, Aminata Niang Diène, vient chaque année en Belgique pour intervenir dans un de mes cours de master », poursuit la professeure.
Les participants
La délégation rassemblait des profils issus de plusieurs facultés de l’UNamur et de services :
- Francesca Cecchet, Faculté des sciences, présidente de l’Institut de recherche NISM (Namur Institute of Structured Matter) et membre de l’Institut de recherche (NaRILIS Namur Research Institute for Life Sciences)
- Laurent Houssiau, Faculté des sciences et membre de l’Institut de recherche NISM (Namur Institute of Structured Matter)
- Charles Nicaise, Faculté de médecine et président de l’Institut de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences)
- Denis Saint-Amand, Faculté de philosophie et de lettres et membre de l’Institut de recherche NaLTT (Namur Institute of Language, Text and Transmediality)
- Laurent Ravez, Facultés de médecine et des sciences et membre des Instituts de recherche NaRILiS (Namur Research Institute for Life Sciences) et EsPhiN (Espace Philosophique de Namur)
- Anne Vermeyen, membre de la Cellule bien-être animal
- Flora Musuamba, Faculté de médecine et membre de l’Institut de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences)
- Florence Georges, Faculté de droit et membre de l’Institut de recherche NaDI (Namur Digital Institute)
- Nathanaël Laurent, Faculté des sciences et membre de l’Institut de recherche EsPhiN (Espace Philosophique de Namur)
- Catherine Linard, Faculté des sciences et membre des Instituts de recherche NaRILIS (Namur Research Institute for Life Sciences) et ILEE (Institute of Life-Earth-Environment)
- Rita Rixen, directrice de la FUCID, le Forum universitaire pour la coopération internationale au développement
- Amélie Schnock, membre du Service des relations internationales
L’Université de Namur à l’international
Engagée dans la coopération internationale et au développement, l’Université de Namur entretient de nombreuses collaborations avec plusieurs institutions dans le monde entier. Ces collaborations se réalisent à travers des projets de recherche, des missions d’enseignement ou de formation, ou encore des formations d'étudiants dans le cadre de l'offre d'enseignement de l'UNamur ou dans le cadre de stages de courte durée, notamment de recherche.
Événements
De la méfiance envers les sciences
Le centre de recherche SPiN vous invite à son événement inaugural.

Pour sa conférence inaugurale, le centre SPiN (Science & Philosophy in Namur) s'entourera d’une juriste et chercheuse au Centre de Bioéthique de l’Université de Namur, Claire Rommelaere, et d’une philosophe des sciences de l’Université de Montréal, Aude Bandini, afin de porter un regard critique sur le thème de la “méfiance envers les sciences”. L’urgence d’aborder cette thématique s’impose à notre époque où, en dépit d’un taux de confiance envers les sciences globalement stable, les repères du débat public demeurent fréquemment brouillés par la désinformation.
Ayant la chance de pouvoir observer les philosophes des sciences dans leur habitat naturel depuis près de quinze ans, Claire Rommelaere partagera ses réflexions sur la question de savoir s’il faut ou non se fier à celles et ceux qui pensent les sciences.
De son côté, Aude Bandini se confrontera à un problème majeur que nous sommes tous amenés à rencontrer à l'heure où la masse des connaissances disponibles est telle qu'il est impossible de les acquérir par soi-même. En effet, le caractère socialement distribué de la connaissance ne nous laisse généralement pas d'autre choix que de nous en remettre, y compris sur des questions très importantes (comme la santé), à l'autorité d'experts. Or, lorsque l'on s'en remet ainsi à autrui et que l'on suit des recommandations dont, en raison de notre ignorance, nous n'avons pas les moyens d'évaluer le bien-fondé, nous nous plaçons dans une relation de "dépendance épistémique" qui entre en tension avec nos aspirations à l'autonomie intellectuelle, et nous force à nous poser une question dont la réponse pourrait s'avérer insupportable : l'autonomie intellectuelle n'est-elle rien de plus qu'un mythe ?
Conférence animée par la journaliste Maïté Warland.
Programme :
- 17h30-18h30 | Drink au Quai 22 (Rue du Séminaire 22 à 5000 Namur)
- 18h30 | Claire Rommelaere
De la méfiance envers les philosophes des sciences - 19h | Aude Bandini
L'autonomie intellectuelle face à l'autorité de la science : un casse-tête pour l'épistémologie sociale
Inscriptions pour le 16 avril au plus tard.
Gratuit.
Le Département de sciences, philosophie et société en vidéo
Plusieurs vidéos expliquent les différentes thématiques de recherche abordées ces dernières années.