L’Institut de recherche Transitions réunit des chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales pour étudier les grandes mutations qui traversent nos sociétés contemporaines. Face aux multiples tensions environnementales, démocratiques, économiques, sanitaires ou encore sociales, nos modèles de développement, nos institutions et nos façons de vivre ensemble sont remis en question.
Les recherches de l’Institut se concentrent sur des domaines d’importance critique tels que l’environnement, la politique, le droit, la justice, la cohésion sociale, le système alimentaire, le développement, l’éducation, les vulnérabilités, etc. S’appuyant sur des approches critiques et mobilisant des perspectives disciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires, l’institut Transitions vise à améliorer la compréhension des enjeux contemporains tout en participant activement à certaines dynamiques de changement sur le terrain.
Grâce à leurs expertises reconnues aux niveaux national et international (F.R.S.-FNRS, Union européenne, État fédéral, Région wallonne, etc.), les membres de l’Institut Transitions développent des projets de recherche fondamentale mais également des projets recherches-action au service de la société.

L’institut s’organise actuellement autour de quatre grands entités :
- Le pôle Transformations Démocratiques s’attache aux évolutions des systèmes politiques, de la représentation électorale, des modes de participation citoyenne et de la légitimité démocratique (Membres permanents: Arthur Borriello, Jérémy Dodeigne et Vincent Jacquet).
- Le pôle Transformations Territoriales et Environnementales propose une lecture systémique des liens entre humains et nature, en promouvant des approches participatives et ancrées localement pour accompagner les transformations socio-écologique à l’échelle des territoires (Membres permanents: Nicolas Dendoncker et Johan Yans).
- Le pôle Transitions et Âges de la Vie s'intéresse aux recompositions des parcours de vie, en mettant en lumière les effets des politiques publiques sur les fragilités individuelles et collectives (Membre permanent : Nathalie Burnay).
- Le centre Vulnérabilités et Sociétés examine, à travers une approche interdisciplinaire, les formes contemporaines de vulnérabilités au sein de l’entreprise, de l’État et de la famille et les transformations du droit engendrées par ces déplacements (Membres permanents : Géraldine Mathieu, Stéphanie Wattier, Marc Nihoul et Nathalie Basecqz).
À la une
Actualités

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.
Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.
Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.
Les résultats en détail
Appel Equipement
- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain
- Luca Fusaro, Institut NISM
Appel Crédits de recherche (CDR)
- Marc Hennequart, Institut NARILIS
- Nicolas Gillet, Institut NARILIS
- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS
- Patricia Renard, Institut NARILIS
- Francesco Renzi, Institut NARILIS
- Stéphane Vincent, Institut NISM
- Laurence Meurant, Institut NaLTT
- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT
Appel Projets de recherche (PDR)
- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB
- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM
Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)
- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM
- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis
- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE
- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)
- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis
- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM
- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE
Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)
- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions
- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP
- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI
- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.
Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)
- Charlotte Beaudart, Institut Narilis
- Eli Thoré Institut ILEE
Appel WelCHANGE
- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain
- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP
Félicitations à tous et toutes !

Y a-t-il un médecin dans le village ? L’analyse d’une sociologue
Y a-t-il un médecin dans le village ? L’analyse d’une sociologue
Le manque de soins de première ligne est un enjeu de santé publique majeur. En 2022, on estimait ainsi que 52 communes de Belgique francophone étaient confrontées à une pénurie sévère de médecins généralistes. Une situation préoccupante à laquelle l’Observatoire universitaire en médecine rurale (OUMRu) s’attaque depuis 2023, dans le but d’identifier des pistes de solutions concrètes. Aux côtés d’un médecin et d’une géographe de la santé, Amélie Pierre, sociologue et chargée de cours à la Faculté Économie Management Communication sciencesPo (EMCP), étudie les ressorts de l’accessibilité aux soins, notamment du point de vue des patients. Elle insiste sur la nécessité d’intégrer les réalités vécues par les publics en situation de vulnérabilité.

Quel est votre rôle au sein de l’Observatoire universitaire en médecine rurale de l’UNamur (OUMRu) ?
Je travaille sur la question de l’accessibilité aux soins. Avec le Docteur Dominique Henrion, nous avons collaboré à une première récolte de données quantitatives via le dispositif « The Social Study » auprès de 5 000 citoyens belges. Cette première étape vise à objectiver les difficultés rencontrées sur le terrain et à en cerner les variations géographiques. Les premiers résultats montrent que nous sommes dans une situation de tension. Dans un second volet qualitatif, nous interrogeons l’évolution du métier et de la relation de soin dans ce contexte. La vision du métier et les pratiques professionnelles ont profondément changé. Je m’intéresse en particulier à des caractéristiques telles que la précarité, l’âge, le genre ou l’état de santé. Elles permettent de montrer des divergences au sein de la population de patients. Si l’on est isolé socialement, en situation de précarité et que l’on souffre de pathologies graves ou chroniques, cette pénurie a un impact fort. Prenons l’exemple des soins palliatifs : actuellement, la situation est grave dans certaines zones, les médecins ne sont plus systématiquement en mesure répondre aux besoins.
Qu’est-ce qui explique cette pénurie ?
Le métier de médecin généraliste a profondément évolué ces dernières années. On observe que la nouvelle génération de médecins s’installe plus volontiers dans les villes, offrant d’autres conditions de travail. Les jeunes médecins qui arrivent sur le marché de l’emploi n’ont pas la même vision du métier que les médecins en fin de carrière. Les questions d’âge et de genre impactent aussi fortement l’évolution du métier. Ces jeunes médecins ne vont plus nécessairement se consacrer corps et âme à leur travail. Ils et elles envisagent un autre équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Un autre aspect tend à disparaitre : la disponibilité du médecin de famille à toute heure ainsi que les déplacements à domicile. Aujourd’hui, le système de mutualisation des gardes est la norme et les médecins ne sont plus rappelables constamment. Il faut donc partir du principe que le métier a changé.
Justement, ce projet rassemble des expertises en médecine, géographie et sociologie. Quelle est pour vous la plus-value de cette collaboration pluridisciplinaire ?
Cette collaboration est extrêmement riche, grâce à la diversité de nos expertises et bagages respectifs. Le regard sociologique permet de saisir les vécus, le sens et les pratiques de la médecine générale en milieu rural. Il s’agit de comprendre la place du médecin de famille dans la santé des patients et la vision du métier en évolution. En géographie, Catherine Linard mène une recherche quantitative avec cet intérêt particulier de la discipline envers le territoire. Ce travail vise à créer un « indice de ruralité » pour identifier où sont implantés les médecins généralistes. L’expertise de la médecine est de travailler, à partir de là, sur l’attractivité des lieux d’implantation notamment. De manière générale, la dimension appliquée du projet me parle beaucoup et c’est l’enjeu de l’observatoire que d’analyser en vue d’agir sur la situation. Il y a une urgence à comprendre ce phénomène, ressenti par l’ensemble de la population et vécu de manière particulièrement aiguë par les personnes en situation de vulnérabilité.
Des solutions sont-elles déjà à l’étude ?
L’interdisciplinarité est très riche sur ce point. En particulier, au travers des liens entre l’Observatoire et le master en médecine générale, Dominique Henrion cherche à cerner les priorités des futurs médecins afin de voir comment agir sur les lieux d’implantations pour corriger les déséquilibres actuels. L’encadrement interdisciplinaire d’une doctorante, financée avec la Mutualité chrétienne dans le cadre d’un FSR, nous permettra également d’avancer dans cette optique (voir encadré).
Vous menez également des recherches en sociologie du travail et en gérontologie, qui est l’étude du vieillissement. Quel est votre angle de travail ?
Je m’inscris dans le courant de la gérontologie critique, qui questionne les structures sociales qui pèsent sur les personnes âgées. Par exemple, le recul de l’âge de la retraite reflète une tendance à devoir et à vouloir rester actif, pour maintenir un certain niveau de vie, mais aussi pour continuer à prendre part à la société. Je travaille avec Nathalie Burnay, professeure ordinaire à la Faculté EMCOP, sur un projet FNRS co-financé avec le FNS Suisse, qui compare la façon dont le travail est vécu et perçu par des personnes vieillissantes, après l’âge de la retraite. Cela soulève des questions liées à la fin de vie et à la manière dont les individus repensent leur identité à l’aune de normes sociales assez âgistes et valorisant l’activité. Cette collaboration de quatre ans s’inscrit dans les projets que je mène au sein de l’Institut Transitions, qui explorent la recomposition des rôles sociaux tout au long de la vie, notamment sous le prisme des inégalités et de la relation d’aide, des enjeux que l’on retrouve dans le travail mené par l’OUMRu.
CV express
Amélie Pierre est détentrice d’un doctorat en sciences politiques et sociales. Elle est chargée de cours à l’UNamur et post-doctorante à l’Institut Transitions, dans le Pôle Transitions et Âges de la Vie. Elle est responsable du Centre de recherche CERIAS du Master en Ingénierie et action sociale de l’Henallux et de la HELHa. Elle s’intéresse aux normativités et aux changements identitaires des individus au cours de leur existence, en particulier chez les publics minorisés en lien avec le handicap, l’âge ou la précarité.
Une collaboration inédite
L’UNamur et la Mutualité chrétienne ont noué une collaboration inédite dans le cadre de l’OUMRu. Ce partenariat porte sur le cofinancement d’un projet de recherche ambitieux et multidisciplinaire mené par l’UNamur durant 4 ans, sous la direction d’Amélie Pierre et de Catherine Linard, en vue de décrypter les mécanismes contribuant à la disparité de l’offre en médecine générale en Wallonie et objectiver les pénuries à l’échelle locale.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


L’UNamur en Amérique du Sud
L’UNamur en Amérique du Sud
L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.
L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert
Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »
Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.
Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation
Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.
Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.
C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.
Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »
Retour d’expérience d'une étudiante
« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.
Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.
Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »
- Thaïs Nivaille, étudiante en physique
Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


Assemblées citoyennes : gadgets ou leviers de changement ?
Assemblées citoyennes : gadgets ou leviers de changement ?
Depuis une quinzaine d’années, les dispositifs de démocratie participative et délibérative se multiplient : budgets participatifs, consultations populaires, panels citoyens, etc. Vincent Jacquet, politologue et coordinateur du projet de recherche européen Citizen Impact (projet ERC, European Research Council), étudie l’impact de ces dispositifs du point de vue des gouvernants et des citoyens.
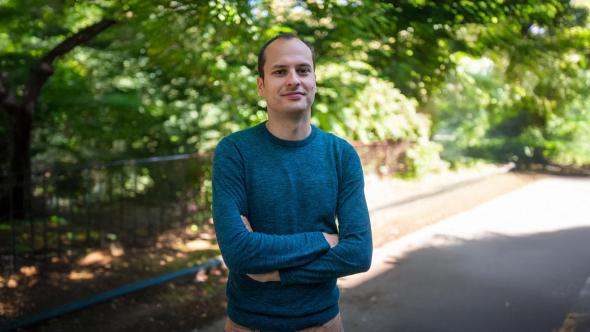
Le constat est nuancé : « Sans grande surprise, les élus actuels sont très ancrés dans une logique électorale et représentative. Beaucoup sont méfiants quant à la capacité des citoyens à s’investir au-delà des processus électoraux. Il y a évidemment des différences parmi les élus et les partis politiques. En simplifiant, on peut dire que plus un parti est à gauche et plus les élus sont jeunes, plus ils vont être ouverts aux mécanismes extra électoraux », explique Vincent Jacquet.
Dès lors, la question est de savoir si les gouvernants intègrent vraiment ces processus citoyens dans leurs décisions politiques. « En politique, les choses changent lentement. Il n’est donc pas étonnant qu’on n’assiste pas à de grandes réformes à court terme. Mais cela ne veut pas dire que les résultats ne sont pas pris en compte », nuance le politologue. Dans certains cas, les recommandations issues des assemblées citoyennes nourrissent les politiques publiques. Dans d’autres, elles restent lettre morte. Il précise cependant que l’absence d’impact tient moins à une volonté de manipulation de la part des élus, qu’au fait que la participation soit pensée à côté des circuits de décision.
Pour renforcer leur impact, trois leviers sont identifiés par le chercheur :
- Inscrire les assemblées dans la durée pour nourrir l’action publique sur le long terme.
- Définir en amont le calendrier et la manière dont les décisions vont être prises par rapport aux recommandations citoyennes.
- Garantir un soutien des recommandations par le politique ou la société civile.
L’exemple irlandais est souvent cité. Des assemblées citoyennes ont préparé le terrain à des référendums sur le mariage pour tous et l’avortement. « C’est l’interaction entre les délibérations d’une assemblée tirée au sort, une mobilisation sociale et l’organisation d’un référendum qui a permis de mener à bien ces réformes. »
De quoi rappeler que ces dispositifs ne remplacent pas la démocratie représentative, mais peuvent l’enrichir, à condition de ne pas rester au stade du symbole.
Sur le même sujet
Une année académique, placée sous la thématique de la démocratie
Retrouvez le discours prononcé par la Rectrice Annick Castiaux lors de la Cérémonie de rentrée académique 2025-2026.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.
Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.
Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.
Les résultats en détail
Appel Equipement
- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain
- Luca Fusaro, Institut NISM
Appel Crédits de recherche (CDR)
- Marc Hennequart, Institut NARILIS
- Nicolas Gillet, Institut NARILIS
- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS
- Patricia Renard, Institut NARILIS
- Francesco Renzi, Institut NARILIS
- Stéphane Vincent, Institut NISM
- Laurence Meurant, Institut NaLTT
- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT
Appel Projets de recherche (PDR)
- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB
- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM
Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)
- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM
- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis
- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE
- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)
- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis
- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM
- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE
Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)
- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions
- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP
- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI
- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.
Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)
- Charlotte Beaudart, Institut Narilis
- Eli Thoré Institut ILEE
Appel WelCHANGE
- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain
- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP
Félicitations à tous et toutes !

Y a-t-il un médecin dans le village ? L’analyse d’une sociologue
Y a-t-il un médecin dans le village ? L’analyse d’une sociologue
Le manque de soins de première ligne est un enjeu de santé publique majeur. En 2022, on estimait ainsi que 52 communes de Belgique francophone étaient confrontées à une pénurie sévère de médecins généralistes. Une situation préoccupante à laquelle l’Observatoire universitaire en médecine rurale (OUMRu) s’attaque depuis 2023, dans le but d’identifier des pistes de solutions concrètes. Aux côtés d’un médecin et d’une géographe de la santé, Amélie Pierre, sociologue et chargée de cours à la Faculté Économie Management Communication sciencesPo (EMCP), étudie les ressorts de l’accessibilité aux soins, notamment du point de vue des patients. Elle insiste sur la nécessité d’intégrer les réalités vécues par les publics en situation de vulnérabilité.

Quel est votre rôle au sein de l’Observatoire universitaire en médecine rurale de l’UNamur (OUMRu) ?
Je travaille sur la question de l’accessibilité aux soins. Avec le Docteur Dominique Henrion, nous avons collaboré à une première récolte de données quantitatives via le dispositif « The Social Study » auprès de 5 000 citoyens belges. Cette première étape vise à objectiver les difficultés rencontrées sur le terrain et à en cerner les variations géographiques. Les premiers résultats montrent que nous sommes dans une situation de tension. Dans un second volet qualitatif, nous interrogeons l’évolution du métier et de la relation de soin dans ce contexte. La vision du métier et les pratiques professionnelles ont profondément changé. Je m’intéresse en particulier à des caractéristiques telles que la précarité, l’âge, le genre ou l’état de santé. Elles permettent de montrer des divergences au sein de la population de patients. Si l’on est isolé socialement, en situation de précarité et que l’on souffre de pathologies graves ou chroniques, cette pénurie a un impact fort. Prenons l’exemple des soins palliatifs : actuellement, la situation est grave dans certaines zones, les médecins ne sont plus systématiquement en mesure répondre aux besoins.
Qu’est-ce qui explique cette pénurie ?
Le métier de médecin généraliste a profondément évolué ces dernières années. On observe que la nouvelle génération de médecins s’installe plus volontiers dans les villes, offrant d’autres conditions de travail. Les jeunes médecins qui arrivent sur le marché de l’emploi n’ont pas la même vision du métier que les médecins en fin de carrière. Les questions d’âge et de genre impactent aussi fortement l’évolution du métier. Ces jeunes médecins ne vont plus nécessairement se consacrer corps et âme à leur travail. Ils et elles envisagent un autre équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Un autre aspect tend à disparaitre : la disponibilité du médecin de famille à toute heure ainsi que les déplacements à domicile. Aujourd’hui, le système de mutualisation des gardes est la norme et les médecins ne sont plus rappelables constamment. Il faut donc partir du principe que le métier a changé.
Justement, ce projet rassemble des expertises en médecine, géographie et sociologie. Quelle est pour vous la plus-value de cette collaboration pluridisciplinaire ?
Cette collaboration est extrêmement riche, grâce à la diversité de nos expertises et bagages respectifs. Le regard sociologique permet de saisir les vécus, le sens et les pratiques de la médecine générale en milieu rural. Il s’agit de comprendre la place du médecin de famille dans la santé des patients et la vision du métier en évolution. En géographie, Catherine Linard mène une recherche quantitative avec cet intérêt particulier de la discipline envers le territoire. Ce travail vise à créer un « indice de ruralité » pour identifier où sont implantés les médecins généralistes. L’expertise de la médecine est de travailler, à partir de là, sur l’attractivité des lieux d’implantation notamment. De manière générale, la dimension appliquée du projet me parle beaucoup et c’est l’enjeu de l’observatoire que d’analyser en vue d’agir sur la situation. Il y a une urgence à comprendre ce phénomène, ressenti par l’ensemble de la population et vécu de manière particulièrement aiguë par les personnes en situation de vulnérabilité.
Des solutions sont-elles déjà à l’étude ?
L’interdisciplinarité est très riche sur ce point. En particulier, au travers des liens entre l’Observatoire et le master en médecine générale, Dominique Henrion cherche à cerner les priorités des futurs médecins afin de voir comment agir sur les lieux d’implantations pour corriger les déséquilibres actuels. L’encadrement interdisciplinaire d’une doctorante, financée avec la Mutualité chrétienne dans le cadre d’un FSR, nous permettra également d’avancer dans cette optique (voir encadré).
Vous menez également des recherches en sociologie du travail et en gérontologie, qui est l’étude du vieillissement. Quel est votre angle de travail ?
Je m’inscris dans le courant de la gérontologie critique, qui questionne les structures sociales qui pèsent sur les personnes âgées. Par exemple, le recul de l’âge de la retraite reflète une tendance à devoir et à vouloir rester actif, pour maintenir un certain niveau de vie, mais aussi pour continuer à prendre part à la société. Je travaille avec Nathalie Burnay, professeure ordinaire à la Faculté EMCOP, sur un projet FNRS co-financé avec le FNS Suisse, qui compare la façon dont le travail est vécu et perçu par des personnes vieillissantes, après l’âge de la retraite. Cela soulève des questions liées à la fin de vie et à la manière dont les individus repensent leur identité à l’aune de normes sociales assez âgistes et valorisant l’activité. Cette collaboration de quatre ans s’inscrit dans les projets que je mène au sein de l’Institut Transitions, qui explorent la recomposition des rôles sociaux tout au long de la vie, notamment sous le prisme des inégalités et de la relation d’aide, des enjeux que l’on retrouve dans le travail mené par l’OUMRu.
CV express
Amélie Pierre est détentrice d’un doctorat en sciences politiques et sociales. Elle est chargée de cours à l’UNamur et post-doctorante à l’Institut Transitions, dans le Pôle Transitions et Âges de la Vie. Elle est responsable du Centre de recherche CERIAS du Master en Ingénierie et action sociale de l’Henallux et de la HELHa. Elle s’intéresse aux normativités et aux changements identitaires des individus au cours de leur existence, en particulier chez les publics minorisés en lien avec le handicap, l’âge ou la précarité.
Une collaboration inédite
L’UNamur et la Mutualité chrétienne ont noué une collaboration inédite dans le cadre de l’OUMRu. Ce partenariat porte sur le cofinancement d’un projet de recherche ambitieux et multidisciplinaire mené par l’UNamur durant 4 ans, sous la direction d’Amélie Pierre et de Catherine Linard, en vue de décrypter les mécanismes contribuant à la disparité de l’offre en médecine générale en Wallonie et objectiver les pénuries à l’échelle locale.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


L’UNamur en Amérique du Sud
L’UNamur en Amérique du Sud
L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.
L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert
Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »
Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.
Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation
Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.
Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.
C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.
Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »
Retour d’expérience d'une étudiante
« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.
Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.
Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »
- Thaïs Nivaille, étudiante en physique
Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


Assemblées citoyennes : gadgets ou leviers de changement ?
Assemblées citoyennes : gadgets ou leviers de changement ?
Depuis une quinzaine d’années, les dispositifs de démocratie participative et délibérative se multiplient : budgets participatifs, consultations populaires, panels citoyens, etc. Vincent Jacquet, politologue et coordinateur du projet de recherche européen Citizen Impact (projet ERC, European Research Council), étudie l’impact de ces dispositifs du point de vue des gouvernants et des citoyens.
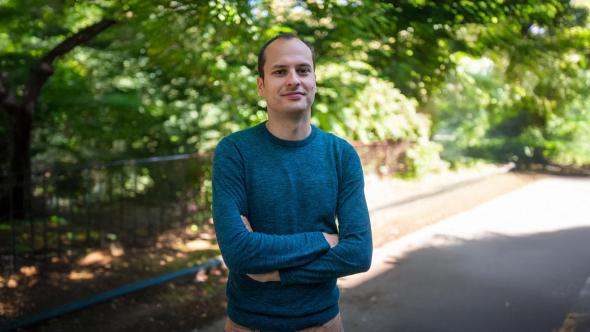
Le constat est nuancé : « Sans grande surprise, les élus actuels sont très ancrés dans une logique électorale et représentative. Beaucoup sont méfiants quant à la capacité des citoyens à s’investir au-delà des processus électoraux. Il y a évidemment des différences parmi les élus et les partis politiques. En simplifiant, on peut dire que plus un parti est à gauche et plus les élus sont jeunes, plus ils vont être ouverts aux mécanismes extra électoraux », explique Vincent Jacquet.
Dès lors, la question est de savoir si les gouvernants intègrent vraiment ces processus citoyens dans leurs décisions politiques. « En politique, les choses changent lentement. Il n’est donc pas étonnant qu’on n’assiste pas à de grandes réformes à court terme. Mais cela ne veut pas dire que les résultats ne sont pas pris en compte », nuance le politologue. Dans certains cas, les recommandations issues des assemblées citoyennes nourrissent les politiques publiques. Dans d’autres, elles restent lettre morte. Il précise cependant que l’absence d’impact tient moins à une volonté de manipulation de la part des élus, qu’au fait que la participation soit pensée à côté des circuits de décision.
Pour renforcer leur impact, trois leviers sont identifiés par le chercheur :
- Inscrire les assemblées dans la durée pour nourrir l’action publique sur le long terme.
- Définir en amont le calendrier et la manière dont les décisions vont être prises par rapport aux recommandations citoyennes.
- Garantir un soutien des recommandations par le politique ou la société civile.
L’exemple irlandais est souvent cité. Des assemblées citoyennes ont préparé le terrain à des référendums sur le mariage pour tous et l’avortement. « C’est l’interaction entre les délibérations d’une assemblée tirée au sort, une mobilisation sociale et l’organisation d’un référendum qui a permis de mener à bien ces réformes. »
De quoi rappeler que ces dispositifs ne remplacent pas la démocratie représentative, mais peuvent l’enrichir, à condition de ne pas rester au stade du symbole.
Sur le même sujet
Une année académique, placée sous la thématique de la démocratie
Retrouvez le discours prononcé par la Rectrice Annick Castiaux lors de la Cérémonie de rentrée académique 2025-2026.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Événements
Séminaire "Methods" | Approches computationnelles du changement sémantique
"Methods" est une série de séminaires organisés par l'Institut Transitions de l'Université de Namur dans le but de favoriser la collaboration interdisciplinaire et l'échange de connaissances. Tous les séminaires se déroulent sous forme hybride.
Oratrice : Barbara McGilivray - Senior Lecturer in Digital and Computational Humanities at King's College London
Le changement sémantique, c'est-à-dire l'évolution du sens des mots au fil du temps, offre des informations cruciales sur les processus historiques, culturels et linguistiques. La langue agit comme un miroir des changements sociétaux, reflétant l'évolution des valeurs, des normes et des progrès technologiques. Comprendre comment le sens des mots évolue nous permet de retracer ces transformations et d'acquérir une compréhension plus approfondie de notre passé lointain et récent.
Ce séminaire explore la manière dont les méthodes computationnelles révolutionnent notre capacité à analyser le changement sémantique dans les textes historiques, relevant ainsi un défi majeur dans le domaine des humanités numériques. Si les méthodes computationnelles avancées nous permettent d'analyser de vastes ensembles de données et de mettre au jour des modèles auparavant inaccessibles, rares sont les algorithmes de traitement du langage naturel qui tiennent pleinement compte de la nature dynamique du langage, en particulier de la sémantique, qui est essentielle pour la recherche en sciences humaines. À mesure que les systèmes d'IA se développent pour mieux comprendre le contexte historique et la dynamique du langage, l'annotation et l'interprétation humaines restent essentielles pour saisir les nuances du langage et son contexte culturel.
Dans cette présentation, je montrerai comment les approches computationnelles et centrées sur l'humain peuvent être combinées efficacement pour examiner le changement sémantique et ses liens avec les développements culturels et technologiques. Je présenterai des exemples illustrant comment le changement sémantique peut être analysé à travers les dimensions temporelles, culturelles et textuelles.
Les séminaires "Methods"
Le séminaire sur les méthodes est une série de séminaires organisés à l'Université de Namur dans le but de favoriser la collaboration interdisciplinaire et l'échange de connaissances. Tous les séminaires se déroulent sous forme hybride.
Cette série de séminaires se concentre sur les approches méthodologiques avancées, en particulier dans les domaines du traitement du langage naturel (NLP), de l'intelligence artificielle (IA), de l'analyse vidéo et d'images, et de l'analyse multimodale.
Pour rester informé des détails des prochains séminaires, merci de vous inscrire à notre liste de diffusion ci-dessous.










