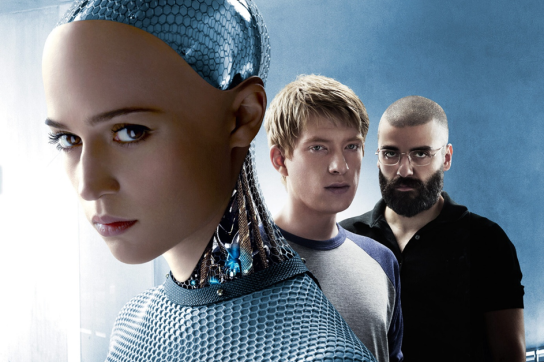Depuis 2022, la Faculté de droit fait le choix d’un thème d’année qui réunit toute la Faculté, étudiants et enseignants, tous blocs et programmes confondus. Ce fil conducteur est exploité dans les cours, encadrements, travaux, tournois d'éloquences, conférences et activités pédagogiques et culturelles proposées au fil de l'année académique. Une dynamique enthousiasmante et porteuse de valeurs qui rend toujours un peu plus unique l'encadrement de l'Université de Namur.
Ainsi, en 2022-2023, nous nous sommes réunis autour de l’ENFANCE & la MIGRATION, en 2023-2024, autour du HARCELEMENT sous toutes ses formes, en 2024-2025, autour de l'INCLUSION, avec l'objectif de permettre à chacun.e de trouver sa place dans la société sans considération de race, sexe, classe sociale, génération, capacité, préférences amoureuses et/ou sexuelles,… Au fil de l'année, nous avons été sensibilisés au racisme, aux LGBTQIA+, aux moins valides, aux personnes âgées ou très jeunes, à la grossophobie, …
La thématique 2025-2026 : L'environnement, avec le slogan "Réenchantons la Terre"

Nous avons choisi cette année de mettre au centre de nos initiatives pédagogiques l'ENVIRONNEMENT, un des trois grands piliers du développement durable.
Objectifs
- Nous réunir (horaire décalé et horaire de jour ; BAC 1, BAC 2 et BAC 3, centres de recherches et masters spécialisés)
- Plonger dans la pratique et concrétiser les cours
- Conscientiser que le droit est un (bon) outil au service de valeurs
- Décloisonner les matières dans une approche transversale
- Devenir un juriste engagé
- S’enrichir la tête et le cœur !
Méthodologie
- Au travers des différents cours, TP, travaux (méthodo et TFC), par une concrétisation de la matière enseignée ;
- Dans le cadre d’activités complémentaires proposées : rencontre de professionnels du droit, pièces de théâtre, films, débats, ...
Activités
- Des illustrations et des conférences dans les cours magistraux
- L'intervention de nombreux spécialistes qui apportent leurs compétences et l'éclairage du "terrain"
- Des activités facultaires en marge des cours (procès simulé, tournoi d’éloquence, …)
- Des activités d'engagement citoyen (cette année : vide dressing, donnerie nomade, ... outre la collecte solidaire initiée l'an dernier pour rencontrer les besoins de la population paupérisée de Namur durant l'hiver)
- Des activités culturelles
- D'autres activités enrichissantes (concours de réalisation de capsules vidéos de sensibilisation,…)
Le Fil rouge des années précédentes
À la une
Événements
Conférence du REHNam | La « vérité » à l’ère numérique : entre lutte contre les manipulations de l’information et protection de l’information de qualité ?
Conférence donnée par Alexandra Michel, professeure à la Faculté de droit et membre du NADI (Namur Digital Institute) et du CRIDS (Centre de Recherche Information, Droit, Société).

Ces dernières années, le débat public se voit régulièrement malmené par diverses opérations de travestissement de « l'information ». Si le phénomène est aussi ancien que l’information elle-même, le numérique, la puissante interactivité offerte par les plateformes en ligne et les récents développements de l’intelligence artificielle générative confèrent une résonance tout autre au phénomène. Les manipulations de l’information en ligne circulent avec une viralité extrême et touchent en quelques minutes les internautes à travers le monde. Elles génèrent de sérieux risques pour la société et menacent la démocratie et l’État de droit. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler des évènements tels que les élections présidentielles américaine et française, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, l’attaque terroriste lors du festival Nova en 2023 et la guerre à Gaza.
Face à ce phénomène, les acteurs de tous les secteurs se mobilisent depuis quelques années. La présente conférence propose, sous l’angle du droit européen, un regard juridique sur les manipulations de l’information en ligne au regard de la liberté d’expression et du droit à l’information. Elle s’intéresse, d’une part, à la réponse du législateur de l’Union européenne pour lutter contre la désinformation en ligne et, d’autre part, aux mécanismes de protection de l’information de « qualité ».
Entrée libre.
Chaire Francqui 2025-2026 en Faculté de droit | Besoin d'environnement, besoin de droit ?
Leçon 2 | Le droit de l’environnement menacé de disparition ?
Oratrice : Delphine Misonne, Maître de recherches FNRS, Professeure à l'UCLouvain, Directrice du CEDRE et membre de l'Académie royale de Belgique.

Cette Chaire Francqui offre un regard neuf sur les avancées mais aussi les tensions qui caractérisent aujourd’hui la manière dont le droit organise la relation de la société à l’environnement, en tant que substrat essentiel à la vie humaine et à l’équilibre des écosystèmes. Loin de présenter ce droit comme ayant atteint son paroxysme, ce sont de ses avancées récentes majeures dont il sera discuté, ainsi que des risques de régression qui le menacent. Si l’ambition de protéger l’environnement est bien devenue une question juridique, comment ses ressorts essentiels sont-ils en train d’évoluer, que ce soit en matière climatique, dans le rapport à la santé humaine ou encore au statut accordé à la nature ?
La conférence sera suivie d'un drink local proposé par le Cercle de Droit, la Régionale la Binchoise et la Régionale RTM.
Évènement gratuit. Inscription vivement souhaitée.
Accueil à partir de 17h30. Début de la leçon à 18h.
Chaire Francqui 2025-2026 en Faculté de droit | Besoin d'environnement, besoin de droit ?
Leçon 3 | Délégaliser la pollution : la santé et le climat au cœur du propos
Oratrice : Delphine Misonne, Maître de recherches FNRS, Professeure à l'UCLouvain, Directrice du CEDRE et membre de l'Académie royale de Belgique.

Cette Chaire Francqui offre un regard neuf sur les avancées mais aussi les tensions qui caractérisent aujourd’hui la manière dont le droit organise la relation de la société à l’environnement, en tant que substrat essentiel à la vie humaine et à l’équilibre des écosystèmes. Loin de présenter ce droit comme ayant atteint son paroxysme, ce sont de ses avancées récentes majeures dont il sera discuté, ainsi que des risques de régression qui le menacent. Si l’ambition de protéger l’environnement est bien devenue une question juridique, comment ses ressorts essentiels sont-ils en train d’évoluer, que ce soit en matière climatique, dans le rapport à la santé humaine ou encore au statut accordé à la nature ?
La conférence sera suivie d'un drink local proposé par le Cercle de Droit, la Régionale la Binchoise et la Régionale RTM.
Évènement gratuit. Inscription vivement souhaitée.
Accueil à partir de 17h30. Début de la leçon à 18h.