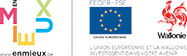Catherine Fonck
 Vous avez débuté vos études de médecine à Namur. Pourquoi avoir choisi cette université ?
Vous avez débuté vos études de médecine à Namur. Pourquoi avoir choisi cette université ?
Il y a d’abord une raison de proximité géographique. À ce moment-là, j’habitais à Ciney. J’ai longtemps hésité entre les études de médecine et d’ingénieur civil. Quand j’ai décidé de faire la médecine, mes parents m’ont poussée à aller dans une université proposant un enseignement pédagogique particulier, pour permettre une transition suffisamment accompagnée entre le secondaire et l’université.
Si vous deviez définir l’Université de Namur, sa particularité, qu’en diriez-vous ?
L’excellence et la rigueur me semblent essentielles dans cette université. À Namur, je pense qu’on pousse vraiment les étudiants à s’engager dans leurs études. En médecine, j’ai d’ailleurs appris à être plus rigoureuse qu’en secondaire. La qualité de l’enseignement et le niveau d’excellence m’ont permis d’avoir plus de facilités après, pour mon doctorat à l’UCL. Ce qui fait aussi la particularité et le charme de cette université, c’est le campus intégré dans la ville.
À cette époque, vous étiez plutôt studieuse ou « sorteuse » ?
J’étais plutôt studieuse. Même si je connais un peu le Bunker, je n’étais pas une régulière de ces soirées (ndlr : soirées organisées par l’Assemblée Générale des Étudiants).
Après trois années passées à Namur, quelle serait l’anecdote ou le souvenir que vous voudriez partager avec nous ?
En médecine, les premiers jours, les professeurs répétaient les uns après les autres : « Regardez votre voisin de droite et votre voisin de gauche. À la fin de l’année, il n’y en aura plus qu’un des trois ». Sur le moment, quand on a 18 ans, ça nous refroidit ! Et après coup, je me suis dit que ça m’avait fait prendre conscience qu’en médecine, il fallait travailler tout de suite et qu’il y avait beaucoup d’exigences.
Un autre souvenir de mes années de Namur, c’est mon squelette, baptisé Oscar. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est quelque chose qui m’a vraiment frappée : pendant deux ans, j’ai eu ce squelette dans mon bureau pour travailler. Et je crois que tous les étudiants en médecine, ou quasi tous, ont aussi leur squelette !
J’ai aussi été marquée par les premiers cours de dissection. C’est un moment très particulier : on dépasse l’approche ex cathedra des cours d’anatomie en auditoire ou en laboratoire, et c’est la première fois qu’on touche un patient. C’est un moment très intense, car on est en contact avec ce qui fera ensuite notre quotidien, mais en même temps, c’est vraiment très particulier, avec le premier contact direct d’un cadavre que l’on doit disséquer…
 Un professeur vous a-t-il particulièrement marquée à Namur ?
Un professeur vous a-t-il particulièrement marquée à Namur ?
Francis Zech (ci-contre), que j’ai eu en microbiologie. C’était un des premiers cours où l’on rentrait vraiment dans la médecine en tant que telle, un cours fondamental pour tout le cursus et pour la médecine au quotidien. Ce professeur avait une capacité de transformer l’apprentissage théorique en une histoire racontée, pour chaque microbe et maladie. Il faisait passer de l’humour et rendait l’apprentissage d’une matière très exigeante, plus facile et plus directe à travers la manière dont il l’exposait. Chaque cours était une nouvelle aventure !
Dans le contexte actuel, où le Ministre Marcourt a décidé d’instaurer un concours en fin de première année, entameriez-vous encore des études de médecine ?
Oui, parce que j’étais et je reste passionnée par la médecine. Je peux comprendre que ça fasse peur aux gens. C’est vrai qu’on a une pression terrible, qu’il y a des exigences. Il faut s’engager à fond et ça prend tout notre temps, mais c’est passionnant. Donc je ne regrette pas de l’avoir fait, et je le referais si j’avais 17 ans aujourd’hui.
D’un point de vue politique, que pensez-vous de cette mesure ? Comprenez-vous la position des étudiants de Namur qui préféreraient un examen de sélection avant la première année ?
Il y a un enjeu majeur : en principe, tout médecin belge diplômé doit pouvoir obtenir un numéro INAMI. Il y a une discrimination terrible aujourd’hui, parce que les européens non belges peuvent obtenir aisément un numéro INAMI, alors que dans certains pays, la formation est de moins bonne qualité qu’en Belgique. À titre personnel, j’ai toujours plaidé pour une sélection, non pas à la fin de la première année, mais au début de la première année, avec une année préparatoire réalisée au sein des universités afin que ceux qui ne réussissent pas cette sélection aient la chance de se mettre suffisamment à niveau et de présenter cet examen une deuxième fois. Cela permettrait de rétablir un équilibre par rapport à la diversité de niveaux de l’enseignement secondaire.
Après vos études, vous exercez durant 10 ans en tant que médecin et vous vous engagez ensuite très rapidement dans la politique. Comment expliquez-vous ce tournant dans votre carrière ? Était-ce préparé de longue date ou le fruit du hasard ?
C’est une diagonale à laquelle je ne m’attendais absolument pas, parce que j’ai fait la médecine avec une spécialisation en médecine interne et en néphrologie. J’exerçais comme néphrologue, avec des patients souvent chroniques, donc on formait une famille avec les infirmières et l’équipe de néphrologues… Jamais je n’aurais imaginé faire de la politique. On m’a sollicitée en lien avec des dossiers sur les soins de santé et on m’a encouragée à faire une première campagne électorale. J’ai beaucoup hésité. Et puis je me suis dit que c’était une manière de porter des revendications et des éléments en matière de soins de santé. Mais les choses se sont emballées au-delà de ce que j’aurais pu imaginer ! À la première élection, j’ai été élue directement députée fédérale, et un an après, ministre. Quand on a une diagonale comme ça qui survient, on prend ou on ne prend pas. Et si on prend, on assume. Une fois que j’ai été ministre, ce n’était plus possible de cumuler. J’ai décidé de mettre entre parenthèses l’exercice de la médecine et je me suis investie à 100 % en politique.
Donc vous n’excluez pas de revenir un jour à l’exercice de la médecine ?
Non, pas du tout. Ça reste une passion et je n’exclus pas d’y retourner un jour. Quand je rentre dans un hôpital, quel qu’il soit, j’ai toujours l’impression de rentrer chez moi !
On peut lire sur votre site web que vous aimez l’adrénaline et la vitesse… pas étonnant au vu du train de vie que vous menez ! Est-ce que cela s’applique aussi à vos hobbys ? Qu’aimez-vous faire durant vos temps libres ?
Du temps libre, il n’y en a pas beaucoup. Je le consacre d’abord à mes proches, ma famille, et particulièrement à ma fille de 15 ans. C’est une manière de me ressourcer. En ce qui concerne la vitesse, je suis fanatique du ski alpin. Je ne peux pas passer un hiver sans aller faire du ski. Je me souviens d’ailleurs d’être partie aux sports d’hiver quand j’étais à Namur, après les partiels de janvier. Je m’étais dit : « si je réussis ces partiels, j’irai. » Et j’ai réussi !
L.G. et M.B.