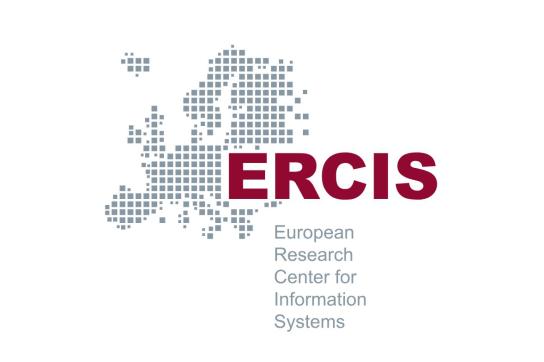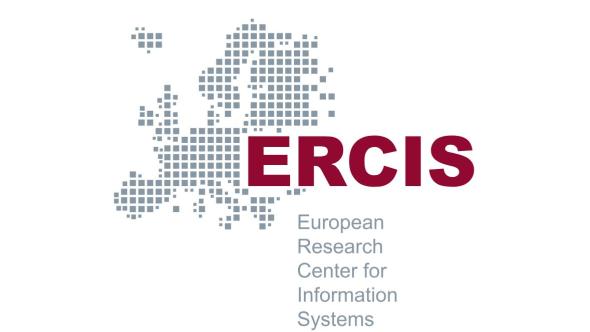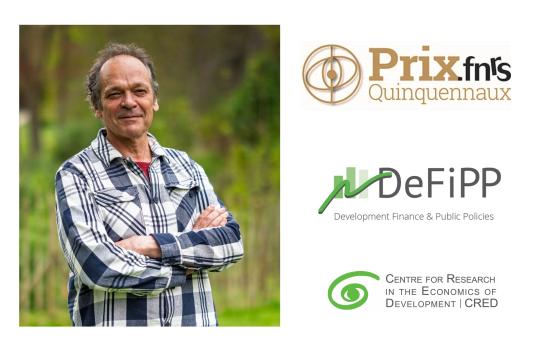La Faculté Economie Management Communication sciencesPo (EMCP) est une Faculté à l'écoute de la personne et ouverte sur le monde. Elle offre des formations dans quatre disciplines majeures, en cours du jour ou en horaire décalé, avec un engagement fort pour l’encadrement et l’accompagnement des étudiants. Elle mène une recherche scientifique d'excellence et interdisciplinaire dans des domaines de pointe. Pour les experts et décideurs de demain !
Les études
La Faculté offre des formations de qualité et de proximité insistant sur la rigueur et l'esprit critique au-delà de la connaissance pure. Elle veille à sensibiliser ses futurs experts et décideurs de demain à la responsabilité sociétale, à l'interdisciplinarité et à la dimension internationale. Les programmes de bachelier, de master et de doctorat qu’elle vous propose s’inscrivent dans quatre disciplines majeures :

Pédagogie : un engagement fort !
La Faculté accorde une importance capitale à l’encadrement et l’accompagnement des étudiants que ce soit en cours du jour ou en horaire décalé. Learning by doing, service learning, hybridation en horaire décalé, … Venez découvrir notre approche pédagogique ainsi que nos différents dispositifs.

À la une
Événements
Lucas Chancel : Quelle transition écologique pour quelle société ?
Ce 23 mars, Lucas Chancel (Sciences Po Paris) présentera son ouvrage « Énergie et Inégalités : Une histoire politique ». En collaboration avec la Librairie Point Virgule.
Description
Pourquoi l’histoire de l’énergie est-elle intimement liée à celle des inégalités sociales ? Comment penser les débats sur la transition énergétique à l’aune des conflits de répartition des richesses ?
Depuis des millénaires, l’usage de l’énergie façonne les sociétés humaines, structurant leurs hiérarchies et leurs rapports de pouvoir. Sa maîtrise est un vecteur d’émancipation autant qu’elle est un outil de domination. La propriété des ressources et des infrastructures énergétiques est un terrain de luttes sociales, politiques et géostratégiques. Selon qui possède l’énergie, des choix de société radicalement différents peuvent advenir.
Mais comment le lien entre énergie et inégalités s’est-il construit depuis la Préhistoire ? En croisant les résultats de la recherche en histoire économique, en archéologie et sciences du climat, Lucas Chancel s’attache à montrer comment, sur la longue durée, les cadres techniques et politiques qui déterminent les usages de l’énergie s’articulent avec la répartition des richesses entre individus, groupes sociaux et nations.
L’histoire de l’énergie ne peut se résumer à sa dimension technique, ni à la somme des choix politiques passés. Elle ouvre sur une diversité de futurs possibles, où le découplage entre consommation d’énergie, ressources matérielles et prospérité est indissociable de la question de la justice sociale.
Ce livre défend une transition écologique fondée sur une réappropriation collective de l’énergie. En puisant dans les expériences de redistribution des richesses du siècle passé, il esquisse une alternative au désastre écologique et aux inégalités extrêmes, à travers le développement de nouvelles formes de propriété publique et participative au XXIe siècle.
Biographie
Lucas Chancel est professeur à Sciences Po Paris, au sein du Centre de recherche sur les inégalités sociales, et co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales à l’École d’économie de Paris. Il a enseigné à l’Université de Harvard aux États-Unis.
Séminaire "Methods" | Approches computationnelles du changement sémantique
"Methods" est une série de séminaires organisés par l'Institut Transitions de l'Université de Namur dans le but de favoriser la collaboration interdisciplinaire et l'échange de connaissances. Tous les séminaires se déroulent sous forme hybride.
Oratrice : Barbara McGilivray - Senior Lecturer in Digital and Computational Humanities at King's College London
Le changement sémantique, c'est-à-dire l'évolution du sens des mots au fil du temps, offre des informations cruciales sur les processus historiques, culturels et linguistiques. La langue agit comme un miroir des changements sociétaux, reflétant l'évolution des valeurs, des normes et des progrès technologiques. Comprendre comment le sens des mots évolue nous permet de retracer ces transformations et d'acquérir une compréhension plus approfondie de notre passé lointain et récent.
Ce séminaire explore la manière dont les méthodes computationnelles révolutionnent notre capacité à analyser le changement sémantique dans les textes historiques, relevant ainsi un défi majeur dans le domaine des humanités numériques. Si les méthodes computationnelles avancées nous permettent d'analyser de vastes ensembles de données et de mettre au jour des modèles auparavant inaccessibles, rares sont les algorithmes de traitement du langage naturel qui tiennent pleinement compte de la nature dynamique du langage, en particulier de la sémantique, qui est essentielle pour la recherche en sciences humaines. À mesure que les systèmes d'IA se développent pour mieux comprendre le contexte historique et la dynamique du langage, l'annotation et l'interprétation humaines restent essentielles pour saisir les nuances du langage et son contexte culturel.
Dans cette présentation, je montrerai comment les approches computationnelles et centrées sur l'humain peuvent être combinées efficacement pour examiner le changement sémantique et ses liens avec les développements culturels et technologiques. Je présenterai des exemples illustrant comment le changement sémantique peut être analysé à travers les dimensions temporelles, culturelles et textuelles.
Les séminaires "Methods"
Le séminaire sur les méthodes est une série de séminaires organisés à l'Université de Namur dans le but de favoriser la collaboration interdisciplinaire et l'échange de connaissances. Tous les séminaires se déroulent sous forme hybride.
Cette série de séminaires se concentre sur les approches méthodologiques avancées, en particulier dans les domaines du traitement du langage naturel (NLP), de l'intelligence artificielle (IA), de l'analyse vidéo et d'images, et de l'analyse multimodale.
Pour rester informé des détails des prochains séminaires, merci de vous inscrire à notre liste de diffusion ci-dessous.
Recherche
Les nombreuses équipes de recherche de la Faculté visent à produire une recherche d'excellence où la qualité prime sur la quantité. En concentrant leurs efforts de recherche dans des domaines de pointe, elles produisent une recherche scientifique, ouverte aux rapprochements interdisciplinaires, ayant un impact sociétal, à l’échelle nationale et internationale. Les recherches menées dans la Faculté nourrissent son enseignement et sa capacité à innover.
International
En plus de l’internationalisation de la vie facultaire (cours et autres activités, étudiants, enseignants), la Faculté offre en Bachelier et en Master des opportunités de mobilité sous la forme de programmes d’échange “cours” (séjour Erasmus Belgica, Erasmus + et hors Europe) ainsi que sous la forme de stages en entreprise et autres organisations à l’étranger !

Le mot du Doyen
Les étudiants sont au cœur de notre métier, ils sont notre joie, notre fierté. En travaillant ensemble, de manière franche, créative et constructive, nous ferons en sorte de la faire briller tant à l’UNamur qu’en dehors de nos murs.