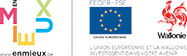L’UNamur et la révolution universitaire
« An avalanche is coming. Higher education and the revolution ahead », tel est le titre du rapport BARBER sur l'évolution de l'université remis en 2013 au gouvernement britannique. Qu’il y ait transformation profonde de l’université à la fois dans ses méthodes d’enseignement, dans sa stratégie de recherche et dans les demandes de la société formulées à son égard, ne fait pas de doute, encore faut-il qu’on en estime les mérites à l’aune de notre mission d’université.
Dans ce contexte, la Fédération Wallonie Bruxelles a entamé une profonde révision du paysage universitaire. Si le décret Marcourt, encore projet, semble derrière nous et campe les acteurs du paysage, bien des incertitudes demeurent sur les moyens de notre enseignement universitaire. Le décret Nollet, voté à la veille des vacances, portant sur le financement de la recherche fondamentale constitue, on le sait, une première pièce de la réflexion gouvernementale à propos du financement de la recherche et au-delà de l’université. Quelle attitude notre université a-t-elle et aura-t-elle face à ces réformes annoncées ou à venir?
Au-delà et de manière plus cruciale, notre université est amenée à s’interroger sur les bouleversements qu’engendrent la ‘globalisation’ de la société et la demande répétée de nos sociétés vis-à-vis des universités, en particulier en période de crise. Ces demandes sont profondément ambigües et il importe que nous nous situions en réponse à elles.
Première partie : Des décrets sur la table et en vue
Le projet de décret MARCOURT, approuvé en troisième lecture par le gouvernement de la FWB, institue une révolution du paysage universitaire de la FWB. Il constitue un triple pari:
- le premier, c’est celui de dépasser les clivages anciens: celui des piliers idéologiques, à la base des anciennes académies et surtout celui des types d’enseignement supérieur: universités, hautes écoles, établissements de promotion sociale et enseignement supérieur artistique;
- le deuxième est de mettre sur pied, au niveau central avec l’ARES et au niveau sous-régional avec les cinq pôles, des instruments de synergie commune entre tous les établissements;
- le troisième est de veiller à privilégier les coopérations entre institutions de façon à éviter des concurrences stériles et coûteuses.
Nous avons déjà affirmé haut et clair tout le bien que nous pensions de ce triple pari, même si le décret prend insuffisamment en compte les perspectives de coopération ou de développement internationaux de nos universités.
- Je le redis. Nous nous réjouissons de cette volonté de décloisonner notre paysage de l’enseignement universitaire. L’expérience de l’Académie universitaire ‘Louvain’ montre tout l’intérêt d’une collaboration tant en matière d’enseignement que de recherche, mais cette expérience montre aussi que cette collaboration au sein de l’académie avait quelques limites et devait s’élargir à une collaboration sur une base non exclusive à l’ensemble des autres institutions, que ce soit en matière de recherches (partage de projets et d’infrastructures) et surtout en matière d’enseignement ( co-diplomations de masters, voire baccalauréats). Ici à Namur, nous entendons, dans le respect des spécificités de chacun, être moteur de telles coopérations sans exclusive aucune. Notre petite taille est un avantage, la proximité qui nous unit est notre force, Namur peut réellement devenir moteur dans le tracé d’un nouveau paysage universitaire où l’union fait la force et notre université entend le faire avec souffle et générosité!
- J’applaudis le développement des collaborations avec les autres types d’enseignement supérieur. Celui-ci se justifie pleinement dans un contexte européen, voire mondial, qui ne connaît pas la division de nos quatre types d’enseignement supérieur. Sans nier la spécificité universitaire mais au contraire en la soulignant, nous découvrirons que bien des complémentarités existent. Ainsi, par exemple, nos centres de recherche ont tout à gagner de la dimension plus appliquée qu’apportent les hautes écoles. Au-delà, des masters communs dans la formation des maîtres, dans la recherche artistique, pourront bénéficier des apports réciproques et, j’insiste, sur pied d’égalité de nos différents types d’enseignement.
Au niveau des pôles en particulier, cette synergie est pleinement justifiée: elle doit s’opérer d’abord au service de l’étudiant par le partage d’infrastructures, par la création de centres de didactique communs aux fins de promouvoir la réussite et par l’encouragement à la mobilité. - Cette synergie doit s’opérer ensuite au service de la société locale non pas un service au balcon mais comme acteur responsable avec les autres acteurs locaux du développement économique et humain de notre beau bassin de vie namurois. Plus que jamais, dans le pôle namurois nous voulons que l’union de tous fasse la force de chacun et c’est avec cette motivation que nous construirons notre paysage. Il s’agit dans un intérêt mutuel, de cibler des actions de formation continue, des recherches et des services en adéquation avec les attentes de la cité. Notre expérience de dix ans de collaboration au sein de la coupole namuroise des établissements d’enseignement supérieur de la Province de Namur témoigne de la vitalité bénéfique à tous les partenaires de cette collaboration. Nous entendons ici, à l’Université de Namur, en être le ferment, conscient du rôle que l’université se doit de jouer dans la vie de la cité. Namur, ville, Namur chef-lieu de Province, Namur, capitale régionale, ouvre des horizons à notre action collective. Bref, Namur plus que jamais, je vous en fais aujourd’hui solennellement la promesse, Monsieur le Président du Parlement de la Région Wallonne, Monsieur le gouverneur de la Province, Monsieur le Bourgmestre.
Je vous l’annonçais d’emblée, d’autres décrets vont changer la vie de nos universités. La question du financement de l’enseignement supérieur soulève des questions plus délicates qui risquent de diviser nos universités et les différents types de réseaux de l’enseignement supérieur. Le Ministre Jean-Marc NOLLET a entrepris la réforme du financement de la recherche fondamentale en stabilisant la dotation du FNRS et en introduisant l’idée d’une recherche fondamentale stratégique financée par les régions. Nous l’en remercions. À propos de ce financement, notre premier souci a toujours été et reste de défendre une approche fondée sur l’excellence et non sur les quotas, héritage du passé, qui pénalisent les universités de taille moyenne. Notre second souci est de maintenir un lien entre les formes traditionnelles de subsides de la recherche (ARC et FSR) et l’enseignement, dans la mesure où cette aide à la recherche a pour vocation première d’appuyer nos enseignants dans leur mission de recherche au service de la formation des acteurs de demain.
Si sur la question du financement de la recherche fondamentale, les débats sont lancés, la réflexion sur celle plus globale du financement de l’enseignement supérieur est à peine entamée et on voit mal quelle direction elle prendra. Nous souhaitons dans ce débat émettre quelques considérations.
- D’abord, redire avec force notre conviction : toute séparation du financement de l’enseignement de celui de la recherche mettrait en péril ce qui est la spécificité de l’enseignement universitaire. La mission première de l’université est de former les intellectuels de demain, des acteurs responsables, créatifs, critiques capables de prendre en main notre futur. Cette tâche, l’université ne peut la remplir que si l’enseignement peut se nourrir de la recherche, s’y ressourcer et préparer au mieux nos jeunes aux défis à venir.
- Dans le même ordre d’esprit, le financement de notre enseignement doit rester lié à l’importance du nombre d’étudiants inscrits même si quelques accommodements peuvent être envisageables et sans doute une analyse plus fine des coûts liés aux divers secteurs qui justifient une pondération différente des étudiants en fonction des secteurs. Par contre, nous excluons catégoriquement un financement en fonction de l’output (étudiants ayant réussi), dans la mesure où il pourrait générer des dérives institutionnelles désastreuses pour la qualité de l’enseignement.
- Troisièmement, l’enveloppe fermée si elle devait être conservée, devrait au minimum être indexée et faire l’objet d’une réévaluation tous les cinq ans en fonction de l’évolution de la population étudiante.
- Quatrièmement : ces dernières années, des fonds spéciaux ont parfois été créés dans le cadre de mesures spécifiques (aide à la réussite, aide à certaines catégories d’étudiants défavorisés, aide pour les études de médecine), etc. Ces créations nous apparaissent partiellement justifiées et pourraient être étendues à d’autres objectifs, dans le cadre de financements complémentaires à l’enveloppe fermée.
- Enfin, des mesures incitatives de financement préférentiel doivent être prévues pour les activités d’enseignement offertes en commun par une ou plusieurs institutions.
Un dernier mot : comment favoriser la réussite à l’Université ? Une étude interuniversitaire invite à surfinancer les universités qui accueillent davantage des étudiants moins bien préparés, pour des raisons sociales et/ou scolaires. C’est à notre avis une fausse bonne réponse à une question légitime. On constate, il est vrai, qu’une partie des étudiants nous arrivent avec des lacunes qui hypothèquent leurs chances de réussite. Les tests d’entrée obligatoires mais non contraignants censés révéler ce déficit ne sont qu’une demie réussite et ne résolvent pas le problème. Je pose dès lors la question : l’Université est-elle le lieu optimal pour combler les lacunes de formation ? L’enseignement secondaire avec ses classes plus réduites, la proximité plus grande enseignants- étudiants n’est-elle pas plus à même de résoudre les difficultés liées à ce passage ? Dès lors pourquoi, et ce en pleine collaboration avec les universités, ne pas envisager une septième année du secondaire pour ceux qui le souhaitent, en particulier ceux dont le test d’entrée a révélé les déficiences ?
Sans doute, dans la foulée, une deuxième idée serait de revenir au système de financement particulier pour la première année où l’on sur-finançait les étudiants de première génération dans la mesure où l’université mettait en œuvre effectivement, rapport à la clé, des outils pédagogiques pour la réussite de cette première année. Ce dispositif invitait les universités à accorder une attention prioritaire à la qualité d'accompagnement des étudiants de première année. Les universités étaient naturellement stimulées à améliorer leurs performances et, au besoin, à remettre en question les méthodes appliquées au service d'une efficacité accrue. L'abandon de ce mécanisme a été un mauvais signal. Un retour à cette pratique constituerait une seconde réponse au problème soulevé par une préparation très variable des élèves à l'entrée à l'université.
Seconde partie : Au-delà de la FWB, la révolution universitaire en marche
Quittons maintenant le niveau de notre Fédération Wallonie Bruxelles pour envisager les mutations au niveau international. La globalisation du monde universitaire est en marche. Elle se caractérise par deux points : le premier est certes la mobilité, tant du personnel enseignant que des étudiants; le second point est la demande croissante mais ambigüe de nos sociétés vis-à-vis du monde universitaire.
Développons le premier point. La mobilité tant des étudiants que du personnel s’accroît avec la complicité des pouvoirs publics qui encouragent cette double mobilité, et surtout, la technologie donne à l’offre universitaire la capacité de s’internationaliser.
Les MOOC (Massive Open Online Courses) en constituent une des manifestations.
Cette mobilité accrue est considérée par les universités, en particulier celles privées, comme un plus dans la mesure où la globalisation permet l’attrait d’étudiants en quantité et qualité supérieures et ce même à des coûts d’inscription plus élevés. Elle permet aussi l’engagement de chercheurs et d’enseignants étrangers. Mais faciliter la mobilité signifie aussi faciliter les comparaisons. Et là force est de constater que nos universités belges, au financement étatique, ne peuvent rivaliser avec d’autres sur le plan des salaires et dès lors se révéler moins attractives pour des chercheurs et professeurs étrangers. Au-delà, sur le marché international, le faible coût des études est parfois perçu comme un signe de mauvaise qualité de celles-ci.
Deux réflexions par rapport à cette situation : la première est, face à ce modèle anglo-saxon, la nécessité que notre monde universitaire, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, réaffirme clairement son attachement au système de service public universitaire qui est le nôtre : un service largement ouvert et sans discrimination aucune aux étudiants de toutes les classes sociales, un système qui refuse de considérer l’étudiant comme un client en attente du ‘return on investment’ que représente le droit d’entrée, un système qui garantit en échange d’un financement public parfois mesuré et de salaires limités, une liberté académique totale et une autonomie à nos universités.
La seconde réflexion vise les rankings. Pour maximiser leur attractivité, les universités ont bon gré mal gré accepté de jouer le jeu des rankings. Ces classements se veulent être un label de qualité tant en enseignement qu’en recherche et la concurrence est rude. Ils introduisent une émulation ce qui en soi constitue un bien. Mais, ceci dit, il est cependant urgent qu’on s’interroge sur les organismes et les critères souvent peu transparents qui président à ces classements et sur leur pertinence par rapport à l’essence même de la mission universitaire : comment sont pris en considération la qualité critique et humaine de la formation, le bien vivre et l’apport à la société? On n’arrêtera pas le mouvement mais au moins on se doit de l’interroger!
Le ranking des institutions pousse à un autre classement, celui des membres de l’université dans la mesure où la qualité de ces derniers justifie, du moins en partie, la qualité de l’institution dont ils relèvent. Ce second ranking (les fameux h.index et le nombre de citations) induit des comportements heureux par l’émulation qu’il crée. Il induit aussi, et il faut le souligner, des comportements plus contestables liés, tout d’abord, à la compétition et l’individualisme auxquels il invite et qui dès lors rendent l’engagement collectif au service de l’université ou de la cité plus difficiles, alors que, rappelons-le, le service à la société est la 3ème mission de notre université. Liés, ensuite, aux effets pervers des critères quantitatifs invitant nos universitaires à multiplier les publications sans toujours questionner le sens de celles-ci, et de la course à la popularité qui les sous-tendent. Plus qu’à la production de savoirs nouveaux et aux risques de la création, les rankings ne nous invitent-ils pas à la reproduction et à la standardisation des savoirs et à des comportements de recherche prudentiels ? Enfin, et de manière plus fondamentale, cette course au ranking est-elle compatible avec la fondation des savoirs et la créativité interdisciplinaire qu’on attend des universités, une fondation qui ne peut se faire que dans le temps long ? En d’autres termes, il est nécessaire et urgent de s’interroger sur le qui, le comment et le pourquoi de ces classements que de plus en plus d’universitaires remettent en cause (voir en particulier la Charte de San Francisco et le mouvement de la Slow Science).
Le deuxième point considère la demande croissante mais ambigüe de la société vis-à-vis de nos universités tant en matière d’enseignement que de recherche.
Cette ambiguïté explique une partie du désarroi des universités et de leurs membres. Ainsi, en ce qui concerne la mission d’enseignement, la société demande à ses universités de prodiguer la formation de ses futurs cadres, responsables, innovants et critiques, ce qui suppose une formation au savoir être, à la créativité, ouverte aux préoccupations de la société et au croisement des savoirs, mais dans le même temps, elle réclame une employabilité immédiate de ceux-ci. Or, cette seconde préoccupation est mieux rencontrée par des formations ‘en ligne’, professionnelles ou d’acteurs privés proposant des profils ‘clé sur porte’. À cet égard, on notera que les MOOC dont nous parlions plus haut sont souvent le fruit d’une coopération entre certaines entreprises spécialistes de la communication et d’experts universitaires réputés mondialement, quand ce n’est pas une mise au service des seconds vis-à-vis des premiers. Faut-il les bannir ? Certes non, mais plutôt les utiliser, à l’image des traditionnels manuels de référence, comme outil de base qui doit être contextualisé et à l’égard duquel s’impose une réflexion critique. L’outil ne peut être instrument de passivité, mais au contraire au service d’apprenants actifs et responsables, de parcours de formation plus personnalisés, notamment en master, à travers la figure de l’étudiant-chercheur, et d’enseignants jouant le rôle d’accompagnateurs et mentors.
En matière cette fois de recherche, la société attend que l’université apporte à la fois de véritables innovations et une réflexion critique qui permettent le ‘bon’ débat et la ‘juste’ décision mais, dans le même temps, elle souhaite que la recherche soit directement valorisable, porteuse à très court terme d’emplois et de retour sur investissement. Dans cette course à la rentabilité à court terme, l’université s’épuise et immanquablement se retrouve en concurrence avec d’autres acteurs avec lesquels elle se doit de nouer des partenariats… parfois, sinon souvent, en position de faiblesse. Il est urgent que nos universités réaffirment leur différence, y compris au risque de perdre quelques financements. Leur plus-value -et c’est celle attendue par la société- se caractérise par l’orientation plus fondamentale de leur recherche, leur qualité de lieu critique du savoir, mais aussi, de brassage interdisciplinaire des savoirs tant nécessaire à l’approche de la complexité des questions scientifiques et sociétales auxquelles nous sommes confrontés, et aussi, la distance éthique qu’elles se doivent d’avoir par rapport à l’immédiateté. S’il ne s’agit pas, bien au contraire, d’exclure au sein de l’université et surtout en partenariat avec les acteurs des hautes écoles et des laboratoires des entreprises, la recherche appliquée, ni la création de spin-off , ces actions doivent rester subordonnées à la vocation fondatrice, ou fondamentale de l’université. C’est cette vocation qui légitime l’action universitaire, et y répondre constitue le véritable apport de l’université à la société.
Pour conclure : la finalité de l’action de l’université est bien le développement de la cité. Elle tient à Namur en trois affirmations :
former des adultes responsables, critiques et autonomes;
développer une recherche fondamentale axée sur le sens de l’interdisciplinarité, le souffle créatif et le souci du questionnement éthique;
mettre ses connaissances au service d’un juste développement de la société.
Voici nos trois missions, inséparables, que poursuivons et que nous allons poursuivre avec plus de force encore en union avec nos collègues des autres universités, y compris à l’étranger, et avec tous les acteurs du pôle namurois…
Namur, plus que jamais, avec humanité, responsabilité et confiance dans l’avenir!