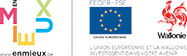Discours de rentrée 2002-2003
Il y a un an, à l’occasion de la séance académique de rentrée, j’ai tenté de montrer que le premier service que l’Université est amenée à rendre à la Société est bien la formation, et pas seulement la transmission d’un savoir disciplinaire pointu, la formation d’hommes et de femmes, d’étudiants et de chercheurs qui soient des acteurs responsables dans la société.
En considérant certaines évolutions récentes, ces propos n’étaient-ils pas prémonitoires ? Ces derniers mois, l’Australie, le Japon, la Nouvelle Zélande et les USA ont déposé, dans le cadre des négociations de l’Accord Général sur le Commerce des Services (le GATS), des demandes d’ouverture au commerce dans le domaine de l’enseignement supérieur. La question fondamentale qui se pose dès lors est de savoir si l’enseignement supérieur et, plus largement, le savoir qui en est l’objet premier, peuvent ou doivent être considérés comme une marchandise.
Souscrire à ce point de vue,
serait soumettre le savoir à l’unique régulation du
marché. Or, peut-on laisser le marché réguler un
domaine largement reconnu en tant que facteur de réduction des
inégalités sociales et source indéniable d’épanouissement
personnel en même temps qu’il est un facteur d’accroissement de la
productivité et de la croissance économique ? De plus, si comme
l’indique la Magna Charta des universités européennes, signée à
Bologne en 1988, l’Université est le « lieu de rencontre
privilégié entre professeurs, ayant la capacité de transmettre le
savoir et les moyens de le développer par la recherche et
l’innovation, et étudiants, ayant le droit, la volonté et la
capacité de s’en enrichir »[1], peut-on admettre que son
accès, son financement, son mode de fonctionnement et ses objectifs
soient déterminés par le marché, avec toutes les dérives que
pareille perspective ne manquera pas d’entraîner ?
Dans le cadre spécifique du GATS, la position de la Communauté
française, telle qu’elle a été présentée par Madame la Ministre
Dupuis lors d’un forum organisé en mai dernier à l’initiative de
l’OCDE, est de défendre l’exclusion des services d’enseignement
supérieur des négociations du GATS. L’enseignement
est et doit rester un service public. Dans notre pays heureusement,
nous avons une longue tradition qui a consacré le primat de la
dimension de « service public » de l’enseignement, y compris
supérieur et universitaire, que celui-ci soit organisé par les
pouvoirs publics ou par des initiatives privées. Selon les
observateurs, c’est cette même position de refus d’intégrer
l’enseignement supérieur dans la liste des matières et services
soumis aux négociations du GATS qui sera vraisemblablement défendue
par l’Union Européenne lors du prochain cycle des négociations, qui
débutera en mars 2003.
Ce dossier, bien que crucial pour les perspectives de l’enseignement
supérieur à l’échelle mondiale, n’est cependant pas le seul à
requérir notre attention. Nombreuses sont en effet les
ombres qui planent sur le caractère de service public de l’
enseignement supérieur en Europe. Attardons-nous un instant à
certains développements en cours à l’échelle européenne mais
aussi mondiale.
Dans le cadre de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « processus de Bologne », l’assignation d’un objectif « professionnalisant » au premier cycle, par exemple, pourrait conduire à ce que la formation soit déterminée en fonction des seuls besoins immédiatement mesurables sur le marché du travail, ou dans l’objectif de favoriser le développement de la flexibilité de l’emploi. Dans cette hypothèse, quelle serait la place laissée à la formation générale ou à la réflexion critique ? Qu’adviendrait-il des formations moins « commercialement rentables » ou non spécifiquement orientées vers le marché ? Quelle possibilité, pour les étudiants, de s’inscrire selon leurs préférences et non selon les seuls besoins du marché ?
De plus, si c’est désormais une structuration en deux cycles qui prévaut, ne sera-t-il pas tentant pour certains états européens de restreindre progressivement le financement public au seul premier cycle ? Comment taire cette question dans le contexte financier difficile qui est celui de l’enseignement supérieur en Communauté française ? Pour rappel, entre 1991 et 1999, le financement public par étudiant à l’Université a diminué de 17 %.
Comment ne pas évoquer aussi les dérives possibles de la tendance de plus en plus affirmée en Europe (et fortement implantée en Amérique du Nord) des universités à recourir à des fonds privés, que ce soit pour le financement de l’enseignement ou de la recherche ? Il faut bien entendu se réjouir des collaborations entre les universités et les entreprises, mais il convient également de veiller à ce que le contenu des formations et les orientations de la recherche puissent être déterminés en toute liberté, sans la pression du court terme, du « directement rentable » ou du « commercialement correct ». A défaut, quel financement serait octroyé à la recherche fondamentale, pourtant vivier reconnu de découvertes ultérieurement exploitées (à l’occasion avec profit) par la recherche plus orientée… ?
Que penser, également, de l’intervention croissante des technologies de l’information et de la communication dans nos modes d’enseignement ? Si leur apport peut être considérable, elles ne restent pas moins un outil qu’il convient de garder « au service » des missions fondamentales d’enseignement et de recherche. Elles sont aussi parfois considérées comme une première porte d’entrée du monde de l’entreprise dans l’Université, ne serait-ce que par l’équipement qu’elles requièrent et les marchés non négligeables qu’elles engendrent. Dans les toutes prochaines années, nous trouverons dans nos grandes surfaces, à côté des rayons d’alimentation, d’hygiène ou de bricolage, des CD susceptibles de nous permettre de décrocher tel ou tel diplôme universitaire, dans le prolongement des formations proposées sur internet. Ne nous y trompons pas : dans cette logique, les enjeux commerciaux prévalent toujours sur l’intérêt commun.
Il y aurait beaucoup à perdre, j’en suis convaincu, à abandonner la relation privilégiée entre enseignant et enseigné au profit d’un « campus purement virtuel ». L’enseignement à distance peut être un précieux outil pédagogique s’il vient en appui du présentiel et non en remplacement. Dans toute la problématique actuelle de l’utilisation des NTIC dans l’enseignement, il nous faut être particulièrement attentifs à ce que l’Université ne se mette au service de la technologie plutôt que d’utiliser ce prodigieux outil pour améliorer la qualité de la transmission des savoirs. A ce propos, vous m’autoriserez cette citation de Riccardo PETRELLA qui s’exprimait, il y a deux ans déjà, en ces termes : « Dialoguer directement de personne à personne, c’est apprendre la centralité de l’altérité dans l’histoire des sociétés humaines, au milieu de tensions créatrices et conflictuelles entre l’unicité et la multiplicité, l’universalité et la spécificité, la globalité et la localité. C’est aussi apprendre la démocratie et la vie. C’est apprendre la solidarité, la capacité de reconnaître la valeur de toute
contribution – si peu qualifiée qu’elle soit par rapport aux critères de productivité et de rentabilité – de tout être humain au vivre ensemble »[2].
Par ailleurs, ce développement met en évidence de façon criante les inégalités entre le Nord et le Sud de la planète. S’il est vrai que les NTIC favorisent la circulation la plus large de l’information au moindre coût, l’évolution en cours ne renforce-t-elle pas la fracture dénoncée depuis longtemps déjà entre les « inforiches » et les « infopauvres » et que l’on appelle aujourd’hui la fracture digitale ?
Mais il ne s’agit là que
d’une facette d’une réalité bien plus vaste : confrontées, tout
comme les universités du Nord mais dans une mesure dramatiquement plus
préoccupante, à des problèmes de financement, les universités du
Sud doivent encore composer avec d’autres effets de la
marchandisation du savoir : fuite des cerveaux, appropriation de la
technologie développée principalement au Nord, droits de propriété
couvrant certaines découvertes scientifiques, appropriation
commerciale par des sociétés occidentales de connaissances
traditionnelles transmises de génération en génération au Sud,
brevetage du vivant… la liste n’est, hélas !, pas
exhaustive.
Ces quelques exemples
l’illustrent bien, la marchandisation du savoir n’est pas
cantonnée au cénacle où se négocie un accord international sur le
commerce des services… il appartient à chacun de nous d’être
vigilant afin que le caractère de service public de notre enseignement
soit préservé.
Une autre dimension essentielle de cette préoccupation est bien évidemment le libre accès à l’enseignement supérieur. C’est à juste titre que les étudiants sont inquiets aujourd’hui face à certaines limitations de l’accès aux études universitaires. Tous les acteurs responsables de notre pays doivent considérer la formation de la jeunesse, et donc l’enseignement supérieur et universitaire, comme une priorité absolue. Contrairement à d’autres états européens, nous avons heureusement en Belgique développé depuis un demi siècle un système de solidarité et de sécurité sociales qui doit permettre et garantir ce libre accès à chacun, quel que soit le niveau de ses revenus. Comme universitaires, il nous revient d’être particulièrement vigilants pour préserver cet héritage de solidarité et résister à toutes les sirènes du chacun pour soi.
Par ailleurs, la limitation actuelle de l’accès à nos universités des étudiants des pays extérieurs à l’Union Européenne, et plus particulièrement des pays du Sud, doit être dénoncée. Cette pratique n’est-elle pas une manière insidieuse de s’aligner sur les lois du marché ? De plus, elle constitue un grave repli sur soi et un appauvrissement certain pour nos communautés universitaires et pour notre pays.
Je
déclare ouverte, sous la garde de Notre-dame de la Paix, cette année
académique 2002-2003.
Michel Scheuer, Recteur
[1] Magna Charta delle Università, Bologna, 18 settembre 1988, http://www.unibo.it/avl/charta/charta.htm
[2] Riccardo Petrella, L’éducation, victime de cinq pièges – A propos de la société de la connaissance, Ed. Fides, Montréal, 2000.