Le Département des sciences sociales, politiques et de la communication regroupe des enseignants et des chercheurs venus d’horizons disciplinaires différents : sciences politiques, information et communication, philosophie, sociologie et droit.
Présentation
Le Département compte 7 académiques, 9 doctorants, 9 chercheurs et post-doctorants et 1 membre du personnel administratif. Il a la responsabilité des enseignements relevant de ces champs disciplinaires dispensés à la Faculté et dirige les programmes de bachelier en sciences politiques et de bachelier en information et communication. Ses membres sont engagés dans des recherches au sein des Instituts de Recherche Transitions et NADI et autour de trois grandes thématiques : digital media & communication, transitions et âge de la vie et transformations démocratiques.
En savoir plus sur le Département des sciences sociales, politiques et de la communication
À la une
Actualités

Assemblées citoyennes : gadgets ou leviers de changement ?
Assemblées citoyennes : gadgets ou leviers de changement ?
Depuis une quinzaine d’années, les dispositifs de démocratie participative et délibérative se multiplient : budgets participatifs, consultations populaires, panels citoyens, etc. Vincent Jacquet, politologue et coordinateur du projet de recherche européen Citizen Impact (projet ERC, European Research Council), étudie l’impact de ces dispositifs du point de vue des gouvernants et des citoyens.
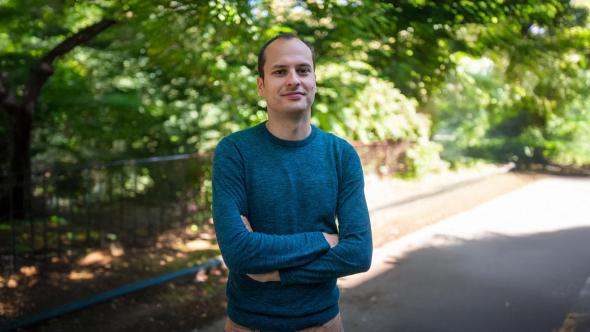
Le constat est nuancé : « Sans grande surprise, les élus actuels sont très ancrés dans une logique électorale et représentative. Beaucoup sont méfiants quant à la capacité des citoyens à s’investir au-delà des processus électoraux. Il y a évidemment des différences parmi les élus et les partis politiques. En simplifiant, on peut dire que plus un parti est à gauche et plus les élus sont jeunes, plus ils vont être ouverts aux mécanismes extra électoraux », explique Vincent Jacquet.
Dès lors, la question est de savoir si les gouvernants intègrent vraiment ces processus citoyens dans leurs décisions politiques. « En politique, les choses changent lentement. Il n’est donc pas étonnant qu’on n’assiste pas à de grandes réformes à court terme. Mais cela ne veut pas dire que les résultats ne sont pas pris en compte », nuance le politologue. Dans certains cas, les recommandations issues des assemblées citoyennes nourrissent les politiques publiques. Dans d’autres, elles restent lettre morte. Il précise cependant que l’absence d’impact tient moins à une volonté de manipulation de la part des élus, qu’au fait que la participation soit pensée à côté des circuits de décision.
Pour renforcer leur impact, trois leviers sont identifiés par le chercheur :
- Inscrire les assemblées dans la durée pour nourrir l’action publique sur le long terme.
- Définir en amont le calendrier et la manière dont les décisions vont être prises par rapport aux recommandations citoyennes.
- Garantir un soutien des recommandations par le politique ou la société civile.
L’exemple irlandais est souvent cité. Des assemblées citoyennes ont préparé le terrain à des référendums sur le mariage pour tous et l’avortement. « C’est l’interaction entre les délibérations d’une assemblée tirée au sort, une mobilisation sociale et l’organisation d’un référendum qui a permis de mener à bien ces réformes. »
De quoi rappeler que ces dispositifs ne remplacent pas la démocratie représentative, mais peuvent l’enrichir, à condition de ne pas rester au stade du symbole.
Sur le même sujet
Une année académique, placée sous la thématique de la démocratie
Retrouvez le discours prononcé par la Rectrice Annick Castiaux lors de la Cérémonie de rentrée académique 2025-2026.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


Université et démocratie : un lien vivant, parfois menacé
Université et démocratie : un lien vivant, parfois menacé
Méfiance envers les institutions politiques traditionnelles et les élus, montée des logiques autoritaires, définancement des services publics… La démocratie semble aujourd’hui traverser une zone de turbulences. Dans ce contexte, quel rôle l’université joue-t-elle ? Pour éclairer cette question, nous avons rencontré quatre chercheurs issus de disciplines différentes : la pédagogue Sephora Boucenna, le philosophe Louis Carré, le politologue Vincent Jacquet, la juriste Aline Nardi. Leurs regards croisés dessinent les contours d’un enjeu plus que jamais d’actualité : penser et défendre le lien entre université et démocratie.

La démocratie n’a rien d’un concept figé. Elle fait débat, surtout aujourd’hui. Louis Carré, directeur du Département de philosophie et membre de l’Espace philosophique de Namur (Institut ESPHIN), en propose une définition en trois dimensions : un régime politique, un état de droit et une manière de faire société.
Le concept de démocratie : entre pouvoir du peuple et centralisation
« Étymologiquement, la démocratie est un régime politique qui consiste à donner le pouvoir au peuple », rappelle-t-il. « Nos démocraties occidentales reposent aujourd’hui sur l’idée que le peuple est souverain, sans pour autant gouverner directement. De là naît une tension entre la démocratie idéale et la démocratie réelle. » Vincent Jacquet, professeur au Département des sciences sociales, politiques et de la communication et président de l’Institut Transitions appuie le propos : « La démocratie est un idéal d’autogouvernement des citoyens, mais il est en tension avec des logiques plus centralisatrices, plus autoritaires. […] Nos systèmes politiques sont traversés par ces différentes tensions, avec à la fois des logiques autoritaires de plus en plus présentes, y compris chez nous, et des logiques de participation qui s’accompagnent parfois de beaucoup d’espoir et de déception aussi. »
Deuxième pilier selon Louis Carré : l’État de droit. La démocratie garantit les droits fondamentaux de tous les citoyens par la constitution. Mais là encore, gare aux paradoxes : « On pourrait en effet imaginer des lois prises par la majorité des représentants ou par un référendum, mais qui contreviennent aux droits fondamentaux », souligne le philosophe. La démocratie ne peut donc se résumer au seul principe majoritaire.
Enfin, la démocratie est également une manière de faire société. Elle repose sur un réel pluralisme : diversité des opinions, des croyances et des valeurs. « Cela suppose l’existence d’un espace public relativement autonome face au pouvoir en place qui, par moment, conteste les décisions prises par les gouvernements qui ont été élus », insiste Louis Carré.
La méfiance des citoyens vis-à-vis du politique n’est, à ce titre, pas nécessairement un symptôme de crise démocratique. Elle peut même en être un signe de vitalité, comme l’explique Vincent Jacquet : « Le fait que les citoyens soient critiques envers leur gouvernement n’est pas forcément négatif parce que, dans une démocratie, les citoyens doivent pouvoir contrôler les actions des gouvernants ».

Former les gouvernants… et les gouvernés
Dans ce contexte, quelle est la responsabilité de l’université ? Louis Carré rappelle d’abord une réalité simple : une grande partie de nos élus sont passés par les bancs de l’université. Mais sa mission d’enseignement ne s’arrête pas là. « Il s’agit de former des citoyens éclairés, pas seulement des gouvernants. Les universités doivent offrir un enseignement supérieur de qualité, ouvert au plus grand nombre », affirme-t-il.
« La démocratie suppose en effet des citoyens capables de débattre, de réfléchir, de problématiser les enjeux », complète Sephora Boucenna, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation et de la formation et membre de l’Institut de Recherches en Didactiques et Éducation de l’UNamur (IRDENA). Il s’agit donc de former des esprits réflexifs, aptes à interroger leur époque.
Former des enseignants réflexifs, pour des citoyens critiques
L’université forme également ceux qui, demain, éduqueront les générations futures : les enseignants. Et là encore, la démocratie est en jeu.
« Notre mission est de former des enseignants réflexifs qui, eux-mêmes, apprendront à leurs élèves à penser de manière critique », insiste Sephora Boucenna. Cela passe par un travail en profondeur sur l’analyse de pratiques, la construction collective et l’apprentissage du débat, dès la formation initiale des enseignants jusqu'à leur formation continue.

Produire et diffuser du savoir… en toute indépendance
Outre l’enseignement, l’université a également une mission de recherche et de service à la société. Elle produit des savoirs qui peuvent éclairer les politiques publiques, mais aussi les questionner. Cette fonction critique suppose une indépendance réelle vis-à-vis du politique. « Pour analyser avec lucidité les mécanismes démocratiques, y compris ceux que les gouvernements mettent en place, il faut que l’université garde sa liberté de recherche et de parole », souligne Vincent Jacquet.
Louis Carré va plus loin : « Comme la presse, l’université est une forme de contre-pouvoir dans l’espace public ». Il précise par ailleurs qu’« il y a une confusion entre liberté d’opinion et liberté académique. Les savoirs universitaires passent par une série de procédures de vérification, d’expérimentation, de discussion au sein de la communauté scientifique. Cela leur donne une robustesse qui n’est pas celle d’une opinion, d’une valeur, d’une croyance. »

Cette fonction critique de l’université suppose donc une indépendance forte. Or, en Belgique, le financement des universités relève largement du pouvoir politique. « Celane doit pas signifier une mise sous tutelle », alerte Louis Carré. « Mener des recherches critiques, qui ne satisfont pas à court terme des commanditaires, demande une indépendance, y compris de moyens. Il faut des chercheurs en nombre qui puissent analyser différents types de dynamiques. Plus on coupera dans les finances de la recherche, comme c’est le cas aujourd’hui, moins on aura de chercheurs et donc de capacité d’analyse indépendante et de diversité des perspectives », insiste Vincent Jacquet.
Le mouvement « Université en colère », récemment lancé au sein des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, entend dénoncer les effets du définancement. Ses représentants appellent à « garantir les conditions de développement d’une université ouverte, indépendante, de qualité et accessible au plus grand nombre. Face aux défis sociaux, économiques et politiques de notre temps et parce que d’autres choix de société, et donc budgétaires, sont possibles, il est plus que jamais essentiel de renforcer les institutions et les acteurs au cœur de la production du savoir. »
Entre vigilance et engagement : un lien à réinventer
La démocratie ne se limite donc ni aux élections ni aux institutions. Elle repose sur une vigilance collective, portée par les citoyens, les savoirs… et les lieux où ces savoirs se construisent. À ce titre, l’université apparaît comme un maillon essentiel de la vitalité démocratique. À condition de rester indépendante, accessible et ouverte sur la société.
« La démocratie, ce n’est pas seulement une affaire d’institutions. C’est l’affaire de citoyens qui la font vivre et qui s’organisent pour faire valoir leurs perspectives à différents moments », insiste Vincent Jacquet. Une invitation claire à ne pas rester spectateur, mais à participer, avec lucidité et exigence, à la construction d’un avenir démocratique commun.
Sur le même sujet
Une année académique, placée sous la thématique de la démocratie
Retrouvez le discours prononcé par la Rectrice Annick Castiaux lors de la Cérémonie de rentrée académique 2025-2026.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


Prendre en compte la réalité familiale des membres parlementaires : un enjeu de taille pour l'avenir
Prendre en compte la réalité familiale des membres parlementaires : un enjeu de taille pour l'avenir
La conciliation entre vie familiale et carrière politique au sein du Parlement européen pose des défis majeurs, en particulier pour les députés ayant de jeunes enfants. C'est ce que démontre Elena Frech, chercheuse à l'Université de Namur, dans ses recherches récentes sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle au sein des institutions européennes.

Selon Elena Frech, membre de l’Institut de recherche Transitions et du Département des sciences sociales, politiques et de la communication (Faculté EMCP), le manque de membres du Parlement européen parents, et en particulier de mères et de jeunes parents, a un impact direct sur les décisions politiques. "Les parents voient le monde différemment et, s'il y a moins de parents au Parlement, cela affectera inévitablement la politique et les décisions prises", explique-t-elle dans une interview accordée à EUobserver.
La chercheuse met en lumière les difficultés rencontrées par les députés européens pour concilier leur mandat et leur vie de famille. Entre les longues heures de travail, les déplacements entre Strasbourg, Bruxelles et leur circonscription, ainsi que l'absence d'un congé parental formel, de nombreuses élues et élus sont contraints de réduire ou d'interrompre leur carrière politique. "L'absence d'une politique de congé parental, combinée à un emploi du temps exigeant, a poussé certains députés à ne pas se représenter aux élections de 2024", ajoute Elena Frech.
Le Parlement européen ne prévoit actuellement ni congé de maternité ni congé de paternité pour ses membres. Selon Elena Frech, cette absence de reconnaissance officielle du congé parental accentue la pression sur les députés européens parents. "Leur parti perd une voix, car les parents en congé ne peuvent être remplacés pour le vote. La pression pour revenir est donc très forte" (EUobserver).
Un débat essentiel pour l'avenir des institutions européennes
Les recherches d'Elena Frech mettent en évidence un problème structurel au sein des institutions européennes, qui limite la diversité et la représentation des parents, en particulier des femmes, au sein du Parlement européen. Son travail pose une question fondamentale : comment adapter les règlements internes pour mieux prendre en compte la réalité des familles des députés ? Un enjeu de taille pour l'avenir de la démocratie européenne.
Crédits : les passages d’interview de cet article sont issus d'une interview d'Elena Frech réalisée par EUobserver.
Source de l’article EUobserver : Bonneyrat, S. (2025). Is the EU Parliament still letting down female MEPs with children? EUobserver.
Retrouvez les études scientifiques sur lesquelles est basé l’article de l’EUobserver :
Frech, Elena and Sophie Kopsch. 2024. "Beyond Rhetoric: The European Parliament as a Workplace for Parents and Current Reform Debates", Politics and Governance 12.
Frech, Elena. 2024. Mothers, parliamentarians, leaders: career factors influencing women’s representation in the European Parliament – a case study of German parliamentarians. European Politics and Society, 1–19.

Appels FNRS 2024 : Pour penser le travail après l’âge légal de la retraite
Appels FNRS 2024 : Pour penser le travail après l’âge légal de la retraite
Nathalie Burnay, professeure en Faculté EMCP et membre de l’Institut TRANSITIONS, vient d’obtenir un financement PDR du F.R.S-FNRS pour son projet BRIDGE-EXT. En collaboration avec la Haute Ecole de Travail social de Lausanne, elle s’intéressera aux situations et aux raisons qui contribuent à la poursuite de l’activité professionnelles après l’âge légal de la retraite.

A l’heure où les différents gouvernements tentent de nous faire travailler jusqu’à 67 ans, certains travailleurs continuent à travailler après l’âge légal de la retraite.
Le projet BRIDGE-EXT, financé par l’outil PDR du F.R.S-FNRS, vise à mieux comprendre ces situations professionnelles en questionnant à la fois les raisons individuelles et relationnelles qui contribuent à la poursuite de l’activité professionnelle, mais aussi les dynamiques structurelles qui y participent. C’est pour cette dernière raison que les chercheurs ont mis au point un partenariat avec des collègues de suisse romande, sous la supervision de la Prof. Valérie Hugentobler de la Haute Ecole de Travail social de Lausanne (HETSL/HES-SO).
L’intérêt de cette collaboration repose sur la compréhension du travail post-retraite selon des contextes politiques différenciés où les systèmes de retraite sont à la fois assez comparables, mais aussi très différents. Comment dès lors appréhender ce travail, qui pose à la fois la question des choix de vie, mais aussi des contraintes, notamment financières, qui pèsent sur les individus aujourd’hui ?
L’équipe de recherche sera composée de sociologues et anthropologues spécialistes des questions de vieillissement au travail. C’est Amélie Pierre qui sera engagée à l’UNamur pour travailler ces questions, au cœur de l’actualité.
Mini CV
Nathalie Burnay est sociologue et professeure ordinaire à l’Université de Namur (Faculté EMCP). Elle travaille depuis de nombreuses années sur l’analyse des fins de carrière et du vieillissement au travail dans une perspective d’ouverture disciplinaire et interdisciplinaire. Elle aborde ainsi ces problématiques à partir d’une analyse des politiques sociales, de l’évolution des conditions de travail et des transformations normatives du monde contemporain.

Depuis quelques années, son horizon scientifique s’est ouvert aux questions liées aux transmissions, parcours de vie et temporalités ainsi qu'à la sociologie des émotions.
Elle est également membre de l’Institut TRANSITIONS – Pôle Transitions et âges de la vie. Ce pôle étudie la manière dont ces parcours de vie se recomposent en fonction de nouvelles contraintes du social et impératifs normatifs. Il met ainsi l’accent sur la fragilité des populations à tout âge de la vie et également sur les répercussions des dispositifs et mesures politiques sur la construction des parcours de vie. Il rassemble des chercheuses et chercheurs venus d’horizons disciplinaires différents qui analysent à la fois les transformations normatives qui affectent les parcours de vie et les transitions des âges de la vie.
FNRS, la liberté de chercher
Chaque année, le F.R.S.-FNRS lance des appels pour financer la recherche fondamentale. Il a mis en place une gamme d'outils permettant d’offrir à des chercheurs, porteurs d’un projet d’excellence, du personnel scientifique et technique, de l’équipement et des moyens de fonctionnement.


Assemblées citoyennes : gadgets ou leviers de changement ?
Assemblées citoyennes : gadgets ou leviers de changement ?
Depuis une quinzaine d’années, les dispositifs de démocratie participative et délibérative se multiplient : budgets participatifs, consultations populaires, panels citoyens, etc. Vincent Jacquet, politologue et coordinateur du projet de recherche européen Citizen Impact (projet ERC, European Research Council), étudie l’impact de ces dispositifs du point de vue des gouvernants et des citoyens.
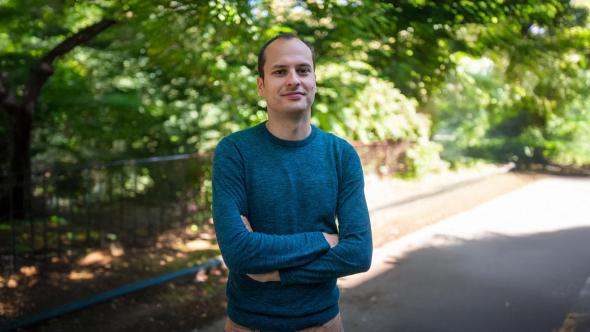
Le constat est nuancé : « Sans grande surprise, les élus actuels sont très ancrés dans une logique électorale et représentative. Beaucoup sont méfiants quant à la capacité des citoyens à s’investir au-delà des processus électoraux. Il y a évidemment des différences parmi les élus et les partis politiques. En simplifiant, on peut dire que plus un parti est à gauche et plus les élus sont jeunes, plus ils vont être ouverts aux mécanismes extra électoraux », explique Vincent Jacquet.
Dès lors, la question est de savoir si les gouvernants intègrent vraiment ces processus citoyens dans leurs décisions politiques. « En politique, les choses changent lentement. Il n’est donc pas étonnant qu’on n’assiste pas à de grandes réformes à court terme. Mais cela ne veut pas dire que les résultats ne sont pas pris en compte », nuance le politologue. Dans certains cas, les recommandations issues des assemblées citoyennes nourrissent les politiques publiques. Dans d’autres, elles restent lettre morte. Il précise cependant que l’absence d’impact tient moins à une volonté de manipulation de la part des élus, qu’au fait que la participation soit pensée à côté des circuits de décision.
Pour renforcer leur impact, trois leviers sont identifiés par le chercheur :
- Inscrire les assemblées dans la durée pour nourrir l’action publique sur le long terme.
- Définir en amont le calendrier et la manière dont les décisions vont être prises par rapport aux recommandations citoyennes.
- Garantir un soutien des recommandations par le politique ou la société civile.
L’exemple irlandais est souvent cité. Des assemblées citoyennes ont préparé le terrain à des référendums sur le mariage pour tous et l’avortement. « C’est l’interaction entre les délibérations d’une assemblée tirée au sort, une mobilisation sociale et l’organisation d’un référendum qui a permis de mener à bien ces réformes. »
De quoi rappeler que ces dispositifs ne remplacent pas la démocratie représentative, mais peuvent l’enrichir, à condition de ne pas rester au stade du symbole.
Sur le même sujet
Une année académique, placée sous la thématique de la démocratie
Retrouvez le discours prononcé par la Rectrice Annick Castiaux lors de la Cérémonie de rentrée académique 2025-2026.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


Université et démocratie : un lien vivant, parfois menacé
Université et démocratie : un lien vivant, parfois menacé
Méfiance envers les institutions politiques traditionnelles et les élus, montée des logiques autoritaires, définancement des services publics… La démocratie semble aujourd’hui traverser une zone de turbulences. Dans ce contexte, quel rôle l’université joue-t-elle ? Pour éclairer cette question, nous avons rencontré quatre chercheurs issus de disciplines différentes : la pédagogue Sephora Boucenna, le philosophe Louis Carré, le politologue Vincent Jacquet, la juriste Aline Nardi. Leurs regards croisés dessinent les contours d’un enjeu plus que jamais d’actualité : penser et défendre le lien entre université et démocratie.

La démocratie n’a rien d’un concept figé. Elle fait débat, surtout aujourd’hui. Louis Carré, directeur du Département de philosophie et membre de l’Espace philosophique de Namur (Institut ESPHIN), en propose une définition en trois dimensions : un régime politique, un état de droit et une manière de faire société.
Le concept de démocratie : entre pouvoir du peuple et centralisation
« Étymologiquement, la démocratie est un régime politique qui consiste à donner le pouvoir au peuple », rappelle-t-il. « Nos démocraties occidentales reposent aujourd’hui sur l’idée que le peuple est souverain, sans pour autant gouverner directement. De là naît une tension entre la démocratie idéale et la démocratie réelle. » Vincent Jacquet, professeur au Département des sciences sociales, politiques et de la communication et président de l’Institut Transitions appuie le propos : « La démocratie est un idéal d’autogouvernement des citoyens, mais il est en tension avec des logiques plus centralisatrices, plus autoritaires. […] Nos systèmes politiques sont traversés par ces différentes tensions, avec à la fois des logiques autoritaires de plus en plus présentes, y compris chez nous, et des logiques de participation qui s’accompagnent parfois de beaucoup d’espoir et de déception aussi. »
Deuxième pilier selon Louis Carré : l’État de droit. La démocratie garantit les droits fondamentaux de tous les citoyens par la constitution. Mais là encore, gare aux paradoxes : « On pourrait en effet imaginer des lois prises par la majorité des représentants ou par un référendum, mais qui contreviennent aux droits fondamentaux », souligne le philosophe. La démocratie ne peut donc se résumer au seul principe majoritaire.
Enfin, la démocratie est également une manière de faire société. Elle repose sur un réel pluralisme : diversité des opinions, des croyances et des valeurs. « Cela suppose l’existence d’un espace public relativement autonome face au pouvoir en place qui, par moment, conteste les décisions prises par les gouvernements qui ont été élus », insiste Louis Carré.
La méfiance des citoyens vis-à-vis du politique n’est, à ce titre, pas nécessairement un symptôme de crise démocratique. Elle peut même en être un signe de vitalité, comme l’explique Vincent Jacquet : « Le fait que les citoyens soient critiques envers leur gouvernement n’est pas forcément négatif parce que, dans une démocratie, les citoyens doivent pouvoir contrôler les actions des gouvernants ».

Former les gouvernants… et les gouvernés
Dans ce contexte, quelle est la responsabilité de l’université ? Louis Carré rappelle d’abord une réalité simple : une grande partie de nos élus sont passés par les bancs de l’université. Mais sa mission d’enseignement ne s’arrête pas là. « Il s’agit de former des citoyens éclairés, pas seulement des gouvernants. Les universités doivent offrir un enseignement supérieur de qualité, ouvert au plus grand nombre », affirme-t-il.
« La démocratie suppose en effet des citoyens capables de débattre, de réfléchir, de problématiser les enjeux », complète Sephora Boucenna, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation et de la formation et membre de l’Institut de Recherches en Didactiques et Éducation de l’UNamur (IRDENA). Il s’agit donc de former des esprits réflexifs, aptes à interroger leur époque.
Former des enseignants réflexifs, pour des citoyens critiques
L’université forme également ceux qui, demain, éduqueront les générations futures : les enseignants. Et là encore, la démocratie est en jeu.
« Notre mission est de former des enseignants réflexifs qui, eux-mêmes, apprendront à leurs élèves à penser de manière critique », insiste Sephora Boucenna. Cela passe par un travail en profondeur sur l’analyse de pratiques, la construction collective et l’apprentissage du débat, dès la formation initiale des enseignants jusqu'à leur formation continue.

Produire et diffuser du savoir… en toute indépendance
Outre l’enseignement, l’université a également une mission de recherche et de service à la société. Elle produit des savoirs qui peuvent éclairer les politiques publiques, mais aussi les questionner. Cette fonction critique suppose une indépendance réelle vis-à-vis du politique. « Pour analyser avec lucidité les mécanismes démocratiques, y compris ceux que les gouvernements mettent en place, il faut que l’université garde sa liberté de recherche et de parole », souligne Vincent Jacquet.
Louis Carré va plus loin : « Comme la presse, l’université est une forme de contre-pouvoir dans l’espace public ». Il précise par ailleurs qu’« il y a une confusion entre liberté d’opinion et liberté académique. Les savoirs universitaires passent par une série de procédures de vérification, d’expérimentation, de discussion au sein de la communauté scientifique. Cela leur donne une robustesse qui n’est pas celle d’une opinion, d’une valeur, d’une croyance. »

Cette fonction critique de l’université suppose donc une indépendance forte. Or, en Belgique, le financement des universités relève largement du pouvoir politique. « Celane doit pas signifier une mise sous tutelle », alerte Louis Carré. « Mener des recherches critiques, qui ne satisfont pas à court terme des commanditaires, demande une indépendance, y compris de moyens. Il faut des chercheurs en nombre qui puissent analyser différents types de dynamiques. Plus on coupera dans les finances de la recherche, comme c’est le cas aujourd’hui, moins on aura de chercheurs et donc de capacité d’analyse indépendante et de diversité des perspectives », insiste Vincent Jacquet.
Le mouvement « Université en colère », récemment lancé au sein des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, entend dénoncer les effets du définancement. Ses représentants appellent à « garantir les conditions de développement d’une université ouverte, indépendante, de qualité et accessible au plus grand nombre. Face aux défis sociaux, économiques et politiques de notre temps et parce que d’autres choix de société, et donc budgétaires, sont possibles, il est plus que jamais essentiel de renforcer les institutions et les acteurs au cœur de la production du savoir. »
Entre vigilance et engagement : un lien à réinventer
La démocratie ne se limite donc ni aux élections ni aux institutions. Elle repose sur une vigilance collective, portée par les citoyens, les savoirs… et les lieux où ces savoirs se construisent. À ce titre, l’université apparaît comme un maillon essentiel de la vitalité démocratique. À condition de rester indépendante, accessible et ouverte sur la société.
« La démocratie, ce n’est pas seulement une affaire d’institutions. C’est l’affaire de citoyens qui la font vivre et qui s’organisent pour faire valoir leurs perspectives à différents moments », insiste Vincent Jacquet. Une invitation claire à ne pas rester spectateur, mais à participer, avec lucidité et exigence, à la construction d’un avenir démocratique commun.
Sur le même sujet
Une année académique, placée sous la thématique de la démocratie
Retrouvez le discours prononcé par la Rectrice Annick Castiaux lors de la Cérémonie de rentrée académique 2025-2026.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).


Prendre en compte la réalité familiale des membres parlementaires : un enjeu de taille pour l'avenir
Prendre en compte la réalité familiale des membres parlementaires : un enjeu de taille pour l'avenir
La conciliation entre vie familiale et carrière politique au sein du Parlement européen pose des défis majeurs, en particulier pour les députés ayant de jeunes enfants. C'est ce que démontre Elena Frech, chercheuse à l'Université de Namur, dans ses recherches récentes sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle au sein des institutions européennes.

Selon Elena Frech, membre de l’Institut de recherche Transitions et du Département des sciences sociales, politiques et de la communication (Faculté EMCP), le manque de membres du Parlement européen parents, et en particulier de mères et de jeunes parents, a un impact direct sur les décisions politiques. "Les parents voient le monde différemment et, s'il y a moins de parents au Parlement, cela affectera inévitablement la politique et les décisions prises", explique-t-elle dans une interview accordée à EUobserver.
La chercheuse met en lumière les difficultés rencontrées par les députés européens pour concilier leur mandat et leur vie de famille. Entre les longues heures de travail, les déplacements entre Strasbourg, Bruxelles et leur circonscription, ainsi que l'absence d'un congé parental formel, de nombreuses élues et élus sont contraints de réduire ou d'interrompre leur carrière politique. "L'absence d'une politique de congé parental, combinée à un emploi du temps exigeant, a poussé certains députés à ne pas se représenter aux élections de 2024", ajoute Elena Frech.
Le Parlement européen ne prévoit actuellement ni congé de maternité ni congé de paternité pour ses membres. Selon Elena Frech, cette absence de reconnaissance officielle du congé parental accentue la pression sur les députés européens parents. "Leur parti perd une voix, car les parents en congé ne peuvent être remplacés pour le vote. La pression pour revenir est donc très forte" (EUobserver).
Un débat essentiel pour l'avenir des institutions européennes
Les recherches d'Elena Frech mettent en évidence un problème structurel au sein des institutions européennes, qui limite la diversité et la représentation des parents, en particulier des femmes, au sein du Parlement européen. Son travail pose une question fondamentale : comment adapter les règlements internes pour mieux prendre en compte la réalité des familles des députés ? Un enjeu de taille pour l'avenir de la démocratie européenne.
Crédits : les passages d’interview de cet article sont issus d'une interview d'Elena Frech réalisée par EUobserver.
Source de l’article EUobserver : Bonneyrat, S. (2025). Is the EU Parliament still letting down female MEPs with children? EUobserver.
Retrouvez les études scientifiques sur lesquelles est basé l’article de l’EUobserver :
Frech, Elena and Sophie Kopsch. 2024. "Beyond Rhetoric: The European Parliament as a Workplace for Parents and Current Reform Debates", Politics and Governance 12.
Frech, Elena. 2024. Mothers, parliamentarians, leaders: career factors influencing women’s representation in the European Parliament – a case study of German parliamentarians. European Politics and Society, 1–19.

Appels FNRS 2024 : Pour penser le travail après l’âge légal de la retraite
Appels FNRS 2024 : Pour penser le travail après l’âge légal de la retraite
Nathalie Burnay, professeure en Faculté EMCP et membre de l’Institut TRANSITIONS, vient d’obtenir un financement PDR du F.R.S-FNRS pour son projet BRIDGE-EXT. En collaboration avec la Haute Ecole de Travail social de Lausanne, elle s’intéressera aux situations et aux raisons qui contribuent à la poursuite de l’activité professionnelles après l’âge légal de la retraite.

A l’heure où les différents gouvernements tentent de nous faire travailler jusqu’à 67 ans, certains travailleurs continuent à travailler après l’âge légal de la retraite.
Le projet BRIDGE-EXT, financé par l’outil PDR du F.R.S-FNRS, vise à mieux comprendre ces situations professionnelles en questionnant à la fois les raisons individuelles et relationnelles qui contribuent à la poursuite de l’activité professionnelle, mais aussi les dynamiques structurelles qui y participent. C’est pour cette dernière raison que les chercheurs ont mis au point un partenariat avec des collègues de suisse romande, sous la supervision de la Prof. Valérie Hugentobler de la Haute Ecole de Travail social de Lausanne (HETSL/HES-SO).
L’intérêt de cette collaboration repose sur la compréhension du travail post-retraite selon des contextes politiques différenciés où les systèmes de retraite sont à la fois assez comparables, mais aussi très différents. Comment dès lors appréhender ce travail, qui pose à la fois la question des choix de vie, mais aussi des contraintes, notamment financières, qui pèsent sur les individus aujourd’hui ?
L’équipe de recherche sera composée de sociologues et anthropologues spécialistes des questions de vieillissement au travail. C’est Amélie Pierre qui sera engagée à l’UNamur pour travailler ces questions, au cœur de l’actualité.
Mini CV
Nathalie Burnay est sociologue et professeure ordinaire à l’Université de Namur (Faculté EMCP). Elle travaille depuis de nombreuses années sur l’analyse des fins de carrière et du vieillissement au travail dans une perspective d’ouverture disciplinaire et interdisciplinaire. Elle aborde ainsi ces problématiques à partir d’une analyse des politiques sociales, de l’évolution des conditions de travail et des transformations normatives du monde contemporain.

Depuis quelques années, son horizon scientifique s’est ouvert aux questions liées aux transmissions, parcours de vie et temporalités ainsi qu'à la sociologie des émotions.
Elle est également membre de l’Institut TRANSITIONS – Pôle Transitions et âges de la vie. Ce pôle étudie la manière dont ces parcours de vie se recomposent en fonction de nouvelles contraintes du social et impératifs normatifs. Il met ainsi l’accent sur la fragilité des populations à tout âge de la vie et également sur les répercussions des dispositifs et mesures politiques sur la construction des parcours de vie. Il rassemble des chercheuses et chercheurs venus d’horizons disciplinaires différents qui analysent à la fois les transformations normatives qui affectent les parcours de vie et les transitions des âges de la vie.
FNRS, la liberté de chercher
Chaque année, le F.R.S.-FNRS lance des appels pour financer la recherche fondamentale. Il a mis en place une gamme d'outils permettant d’offrir à des chercheurs, porteurs d’un projet d’excellence, du personnel scientifique et technique, de l’équipement et des moyens de fonctionnement.




