La Faculté Economie Management Communication sciencesPo (EMCP) a accueilli de nombreux événements au cours de son histoire. Retour en images sur quelques moments marquants de notre Faculté.
Les 60 ans de la Faculté
En octobre 2022, la Faculté fêtait ses 60 ans. Pour marquer cet anniversaire, la Faculté a organisé deux grands événements qui ont donné à tous l’occasion de se retrouver et de partager parcours, expériences, talents et souvenirs !
Le 13 octobre, une conférence-débat autour de la thématique « Nouveaux rythmes scolaires : A l’Université aussi ? » en présence de la Ministre de l’enseignement supérieur et de représentants de partis. Le débat a été modéré par Béatrice Delvaux (Editorialiste en chef, Le Soir). La conférence-débat en intégralité est disponible sur Youtube.
Le 15 octobre, une soirée anniversaire autour du thème « La Faculté a des talents ». Anciens, professeurs, chercheurs et étudiants ont confronté leurs talents à l'aune des défis d’aujourd'hui et de demain: entrepreneuriat, développement durable, transition digitale et pédagogies innovantes ont été au menu d'une séance académique haute en couleur. La séance académique a été suivie par une soirée festive et conviviale autour d'un cocktail, d'un repas et d'un after-dinner. Toutes les photos de l'événement sont disponibles sur la photothèque.
Découvrez la vidéo souvenir de l'événement ici :

Cérémonie de diplomation en bachelier
Le 16 février 2024 a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes des programmes de bachelier en information et communication, en Ingénieur de gestion, en sciences économiques et de gestion et en sciences politiques. Cette cérémonie a été suivie d’un verre de l’amitié, servi par le Cercle des étudiants, rassemblant les diplômés, leurs proches et les membres du personnel de la Faculté. Cette cérémonie a marqué le couronnement de plusieurs années d’efforts et de partage, tant pour les étudiants et leurs proches que pour les membres du personnel.
Colloque "Réformer la Belgique"
Le 10 octobre 2023, un colloque autour du thème « Faut-il réformer la Belgique » a été organisé à la Faculté Economie Management Communication sciencesPo (EMCP). Celui-ci proposait différents panels et également un débat politique entre les représentants des six partis de la Fédération Wallonie Bruxelles et animé par Arnaud Ruyssen (RTBF).
À la une
Actualités

Vingt films pour comprendre le numérique : le pari ludique de deux experts de l’UNamur
Vingt films pour comprendre le numérique : le pari ludique de deux experts de l’UNamur
Terminator pour parler d’IA ? Wall-E pour parler de la dépendance technologique ? The Truman Show pour évoquer les réseaux sociaux ? Dans un nouvel ouvrage, deux professeurs de l’UNamur, Anthony Simonofski (transformation numérique- Faculté EMCP – Institut NaDI) et Benoît Vanderose (Génie logiciel – Faculté d’informatique – Institut NaDI), proposent un voyage à la croisée du numérique et de l’imaginaire cinématographique.

Leur ouvrage « Cinématech - Vingt œuvres pour comprendre le numérique » a une visée avant tout éducative puisqu’il permet au lecteur de mieux comprendre le numérique et ses enjeux. Mais l’originalité de l’approche choisie par les deux auteurs, en fait un outil aussi ludique qu’instructif.
« L’idée est simple : utiliser 20 films et séries pour illustrer l'histoire du numérique, trois technologies importantes (IA, Robotique, XR) et leurs enjeux. Pour ce faire, on part de Terminator, Her, Wall-E, Minority Report et bien d’autres pour rendre ces sujets accessibles », explique Anthony Simonofski Professeur au sein de la Faculté d’économie, management, sciences politiques et communication (EMCP).
Edité par l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, l’ouvrage est le prolongement du Podcast Pop-Code réalisé par les deux experts et cinéphiles. Ils y explorent l'utilisation de la Pop-Culture pour éduquer au numérique, tout en examinant ses enjeux et limites.

« Avec le livre, nous pouvons approfondir le propos du podcast, en fournissant davantage de cohérence et de références scientifiques », précise Benoit Vanderose, professeur au sein de la Faculté d’informatique.
Trois publics sont visés par ce nouvel ouvrage :
- Celles et ceux qui veulent mieux comprendre le numérique sans jargon
- Les cinéphiles curieux de voir leurs œuvres préférées sous un autre angle,
- Les enseignants et formateurs qui cherchent des supports concrets pour parler du numérique en classe
Des séances du numérique à l’UNamur et un projet de recherche
Outre le podcast Pop-Code et l’ouvrage « Cinématech », le projet de Benoit Vanderose et Anthony Simonofski se décline aussi sous la forme de « séances du numérique » organisées à l’UNamur. Au programme ? Des films suivis de débats avec des experts et expertes pour comprendre les défis du numérique et stimuler la réflexion collective. Dans ce projet, Anthony Simonofski, et Benoit Vanderose sont accompagnés d’Anne-Sophie Collard, et Fanny Barnabé. Prochain rendez-vous ? Le 12 février pour une diffusion de I, Daniel Blake (Ken Loach) pour parler d’inclusion numérique !
A noter aussi sur la même thématique : le projet de recherche en cours - https://arc-projects.unamur.be/di-fic

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.
Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.
Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.
Les résultats en détail
Appel Equipement
- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain
- Luca Fusaro, Institut NISM
Appel Crédits de recherche (CDR)
- Marc Hennequart, Institut NARILIS
- Nicolas Gillet, Institut NARILIS
- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS
- Patricia Renard, Institut NARILIS
- Francesco Renzi, Institut NARILIS
- Stéphane Vincent, Institut NISM
- Laurence Meurant, Institut NaLTT
- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT
Appel Projets de recherche (PDR)
- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB
- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM
Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)
- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM
- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis
- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE
- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)
- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis
- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM
- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE
Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)
- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions
- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP
- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI
- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.
Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)
- Charlotte Beaudart, Institut Narilis
- Eli Thoré Institut ILEE
Appel WelCHANGE
- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain
- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP
Félicitations à tous et toutes !
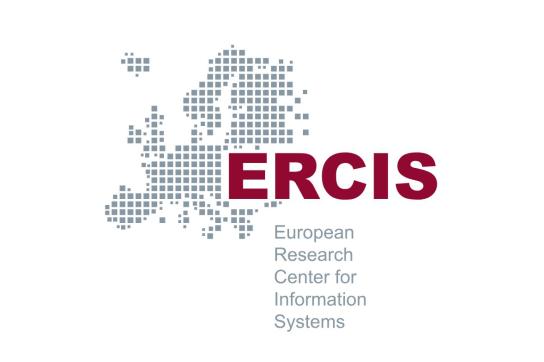
L’UNamur rejoint ERCIS, le réseau européen leader en systèmes d’information
L’UNamur rejoint ERCIS, le réseau européen leader en systèmes d’information
L’Université de Namur franchit une nouvelle étape dans son engagement pour accompagner la transformation numérique. Elle rejoint en effet le prestigieux réseau European Research Center for Information Systems (ERCIS) en tant que Partner Institution, via le centre de recherche MINDIT (Management de l’Information et Transformation Numérique).
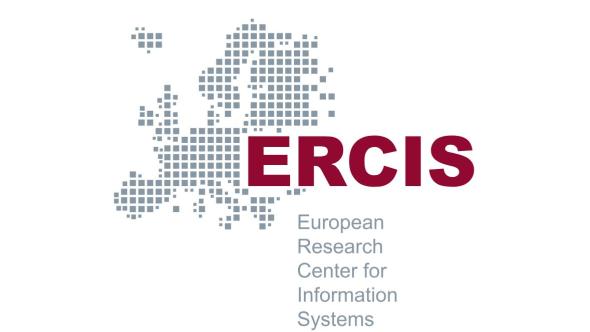
Le réseau ERCIS fédère des universités et des entreprises issues de 25 pays – principalement européens – autour d’un objectif commun : faire progresser la recherche sur les systèmes d’information et relever les défis de la transformation numérique. Pour ce faire, le réseau ERCIS met l’accent sur la recherche collaborative, l’innovation et le partage de connaissances.

Rejoindre ERCIS est une belle marque de reconnaissance envers l’expertise développée par MINDIT et une formidable opportunité de nourrir nos recherches et nos enseignements avec une dimension internationale.
Concrètement, cette adhésion ouvre la voie à des opportunités de formation pour les chercheurs et doctorants de MINDIT : événements de réseautage, workshops annuels, summer school ou encore PhD Colloquium. Elle permet également de créer des ponts pour développer des partenariats au niveau des programmes académiques.
Enfin, ERCIS s’appuie sur un comité consultatif d’entreprises, garantissant une synergie entre recherche et pratiques de terrain.
Centre de recherche MINDIT
Le Centre de recherche MINDIT (NaDI) développe depuis 2024 une expertise dans les systèmes d’information, un domaine de recherche à l’intersection de l’informatique et du management. Les travaux de MINDIT explorent le potentiel des nouvelles technologies (IA, internet des objets, réalité augmentée, big data…) dans l’objectif de répondre aux besoins concrets du monde de l’entreprise et des organisations publiques. MINDIT rassemble plusieurs académiques comme Corentin Burnay (directeur), Isabelle Linden, Stéphane Faulkner ou Annick Castiaux.
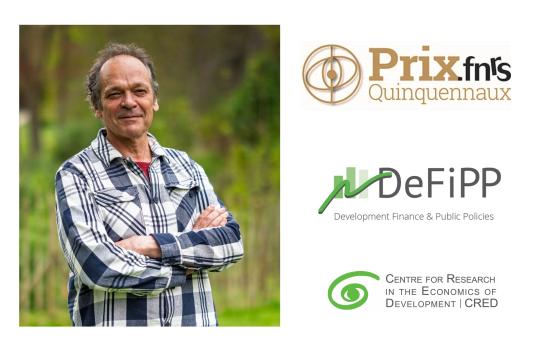
Un prestigieux prix FNRS en sciences sociales pour le Professeur Jean-Marie Baland
Un prestigieux prix FNRS en sciences sociales pour le Professeur Jean-Marie Baland
Le FNRS a décerné le Prix quinquennal Ernest-John Solvay en sciences sociales à Jean-Marie Baland, professeur au Département des sciences économiques de la Faculté EMCP de l’UNamur et cofondateur du Centre de Recherche en Economie du Développement (CRED) de l'Institut DeFiPP. Une reconnaissance majeure pour une carrière consacrée à l’étude des questions de pauvreté, d’institutions informelles et de développement durable.

Le Prix quinquennal Ernest-John Solvay, l’une des distinctions les plus prestigieuses du FNRS, a été attribué ce 24 novembre 2025 à Jean-Marie Baland, professeur au Département des sciences économiques de l’Université de Namur depuis 1991. Ce prix, décerné tous les cinq ans, récompense des chercheurs dont les travaux ont marqué leur discipline par leur originalité et leur impact.
« Jean-Marie Baland allie la rigueur théorique à des études de terrain menées dans des pays tels que l’Inde, le Népal, le Kenya et le Chili. Ses recherches abordent des questions essentielles comme le développement économique, la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement », souligne le jury du FNRS.
Une expertise reconnue internationalement
Spécialiste des pays les moins développés, Jean-Marie Baland a consacré ses travaux à l’analyse des institutions informelles, sujet pour lequel il a obtenu un ERC Advanced Grant en 2009. Ses recherches explorent également les déterminants de la déforestation, les conséquences de la pauvreté, et plus récemment, les causes de la mortalité infantile en Asie du Sud, ou la violence domestique.

La question centrale de mes recherches est de comprendre comment les groupes s’organisent pour la gestion de la prise de décision. Qui en profite ? Qui en est lésé ? Quels impacts cela produit ? J’ai abordé cette thématique sous diverses formes, avec des cas d’études très divers. Par exemple, au Kenya j’ai étudié comment au sein d’un bidonville, un groupement de femmes s’organisaient pour constituer une épargne collective leur permettant de subvenir à leurs besoins. Plus récemment, j’ai étudié le fonctionnement de la prise de décision au sein de couples en Europe. Aujourd’hui, je travaille avec ma collègue Catherine Guirkinger (Faculté EMCP, Département d’économie), sur la question de l’émancipation féminine et de son impact sur la violence domestique : permette-t-elle de la réduire ou de l’augmenter et dans les deux cas pourquoi ? Toutes ces questions sont analysées en s’appuyant sur une méthode interdisciplinaire, avec des approches issues de modèles statistiques, mathématiques et économiques, et des méthodes de sciences sociales comportant des enquêtes de terrain.
L’envie de comprendre le monde
Ce qui le motive depuis toujours ?
« L’envie de comprendre le monde. Ma motivation dans mes recherches a toujours été de produire de la connaissance avant de vouloir qu’elles aient un impact sociétal. L’utilité de la recherche est bien entendu importante, mais personnellement ce n’est pas cela qui me fait avancer. Le résultat de mes recherches est bien entendu régulièrement utilisé pour élaborer des politiques publiques par exemple. Mais cela n’est pas une fin en soi pour mon travail de chercheur », souligne-t-il.
La carrière académique de Jean-Marie Baland a été jalonnée de distinctions prestigieuses : Chaire Francqui (2008), Distinguished Fellow Award à Harvard (2007), membre de l’Academia Europaea (2012)… Autant de reconnaissances qui témoignent de son rayonnement scientifique.
L’UNamur mise en lumière
Mais l’une de ses plus grandes fiertés réside dans la création du centre de recherche en économie du développement (CRED) de l’UNamur, fondée avec le Professeur Jean-Philippe Platteau. Jean-Marie Baland est membre du Centre de recherche en économie du développement (CRED). Un centre aujourd’hui reconnu internationalement pour son expertise en économie du développement, microéconomie appliquée et économie de l’environnement, contribuant à des recherches à fort impact sociétal. « Le CRED compte aujourd’hui cinq académiques et une quinzaine de chercheurs », précise Jean-Marie Baland. L’économiste est aussi un des fondateurs du Master de spécialisation en économie du développement .
A la génération de futurs économistes, Jean-Marie Baland adresse ce souhait :
« Intéressez-vous à des domaines qui ont du sens pour vous ! Et travaillez en équipe, aussi avec des personnes qui pensent différemment de vous. Cette expérience d’interactions humaines a pour ma part été d’une très grande richesse », conclut-il.
Une cérémonie prestigieuse

Ces Prix prestigieux, attribués tous les cinq ans par le FNRS, ont été remis ce 24 novembre 2025 par le Roi Philippe à une chercheuse et cinq chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils confirment la reconnaissance internationale et couronnent la carrière exceptionnelle de ces scientifiques, dans toutes les disciplines. Les Excellentieprijzen du FWO, l’équivalent du FNRS en Flandre, ont également été décernés ce 24 novembre par Sa Majesté le Roi. Lors de cette cérémonie, Véronique Halloin, Secrétaire générale du FNRS, a félicité les lauréats, en remerciant les 42 membres des jurys internationaux mais aussi les mécènes qui rendent possible l’existence de ces Prix. Elle a également évoqué des « questions essentielles pour la recherche scientifique et la société tout entière », insistant sur la nécessité « de conserver le niveau de financement de la recherche fondamentale, de garder toute sa place à une recherche stratégique mais aussi aux sciences humaines et sociales. »
La presse en parle
- Regardez la vidéo de présentation de Jean-Marie Galand (c) The Content Company
- Ecoutez le podcast réalisé par DailyScience avec l’interview de Jean-Marie Baland.
- Téléchargez le communiqué de presse du FNRS.
- Téléchargez la brochure remise lors de la cérémonie

Vingt films pour comprendre le numérique : le pari ludique de deux experts de l’UNamur
Vingt films pour comprendre le numérique : le pari ludique de deux experts de l’UNamur
Terminator pour parler d’IA ? Wall-E pour parler de la dépendance technologique ? The Truman Show pour évoquer les réseaux sociaux ? Dans un nouvel ouvrage, deux professeurs de l’UNamur, Anthony Simonofski (transformation numérique- Faculté EMCP – Institut NaDI) et Benoît Vanderose (Génie logiciel – Faculté d’informatique – Institut NaDI), proposent un voyage à la croisée du numérique et de l’imaginaire cinématographique.

Leur ouvrage « Cinématech - Vingt œuvres pour comprendre le numérique » a une visée avant tout éducative puisqu’il permet au lecteur de mieux comprendre le numérique et ses enjeux. Mais l’originalité de l’approche choisie par les deux auteurs, en fait un outil aussi ludique qu’instructif.
« L’idée est simple : utiliser 20 films et séries pour illustrer l'histoire du numérique, trois technologies importantes (IA, Robotique, XR) et leurs enjeux. Pour ce faire, on part de Terminator, Her, Wall-E, Minority Report et bien d’autres pour rendre ces sujets accessibles », explique Anthony Simonofski Professeur au sein de la Faculté d’économie, management, sciences politiques et communication (EMCP).
Edité par l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, l’ouvrage est le prolongement du Podcast Pop-Code réalisé par les deux experts et cinéphiles. Ils y explorent l'utilisation de la Pop-Culture pour éduquer au numérique, tout en examinant ses enjeux et limites.

« Avec le livre, nous pouvons approfondir le propos du podcast, en fournissant davantage de cohérence et de références scientifiques », précise Benoit Vanderose, professeur au sein de la Faculté d’informatique.
Trois publics sont visés par ce nouvel ouvrage :
- Celles et ceux qui veulent mieux comprendre le numérique sans jargon
- Les cinéphiles curieux de voir leurs œuvres préférées sous un autre angle,
- Les enseignants et formateurs qui cherchent des supports concrets pour parler du numérique en classe
Des séances du numérique à l’UNamur et un projet de recherche
Outre le podcast Pop-Code et l’ouvrage « Cinématech », le projet de Benoit Vanderose et Anthony Simonofski se décline aussi sous la forme de « séances du numérique » organisées à l’UNamur. Au programme ? Des films suivis de débats avec des experts et expertes pour comprendre les défis du numérique et stimuler la réflexion collective. Dans ce projet, Anthony Simonofski, et Benoit Vanderose sont accompagnés d’Anne-Sophie Collard, et Fanny Barnabé. Prochain rendez-vous ? Le 12 février pour une diffusion de I, Daniel Blake (Ken Loach) pour parler d’inclusion numérique !
A noter aussi sur la même thématique : le projet de recherche en cours - https://arc-projects.unamur.be/di-fic

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.
Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.
Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.
Les résultats en détail
Appel Equipement
- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain
- Luca Fusaro, Institut NISM
Appel Crédits de recherche (CDR)
- Marc Hennequart, Institut NARILIS
- Nicolas Gillet, Institut NARILIS
- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS
- Patricia Renard, Institut NARILIS
- Francesco Renzi, Institut NARILIS
- Stéphane Vincent, Institut NISM
- Laurence Meurant, Institut NaLTT
- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT
Appel Projets de recherche (PDR)
- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB
- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM
Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)
- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM
- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis
- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE
- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)
- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis
- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM
- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE
Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)
- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions
- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP
- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI
- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.
Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)
- Charlotte Beaudart, Institut Narilis
- Eli Thoré Institut ILEE
Appel WelCHANGE
- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain
- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP
Félicitations à tous et toutes !
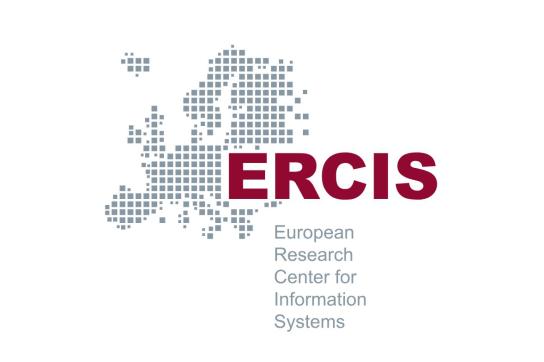
L’UNamur rejoint ERCIS, le réseau européen leader en systèmes d’information
L’UNamur rejoint ERCIS, le réseau européen leader en systèmes d’information
L’Université de Namur franchit une nouvelle étape dans son engagement pour accompagner la transformation numérique. Elle rejoint en effet le prestigieux réseau European Research Center for Information Systems (ERCIS) en tant que Partner Institution, via le centre de recherche MINDIT (Management de l’Information et Transformation Numérique).
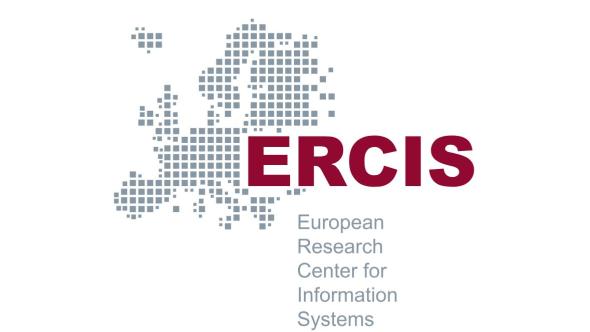
Le réseau ERCIS fédère des universités et des entreprises issues de 25 pays – principalement européens – autour d’un objectif commun : faire progresser la recherche sur les systèmes d’information et relever les défis de la transformation numérique. Pour ce faire, le réseau ERCIS met l’accent sur la recherche collaborative, l’innovation et le partage de connaissances.

Rejoindre ERCIS est une belle marque de reconnaissance envers l’expertise développée par MINDIT et une formidable opportunité de nourrir nos recherches et nos enseignements avec une dimension internationale.
Concrètement, cette adhésion ouvre la voie à des opportunités de formation pour les chercheurs et doctorants de MINDIT : événements de réseautage, workshops annuels, summer school ou encore PhD Colloquium. Elle permet également de créer des ponts pour développer des partenariats au niveau des programmes académiques.
Enfin, ERCIS s’appuie sur un comité consultatif d’entreprises, garantissant une synergie entre recherche et pratiques de terrain.
Centre de recherche MINDIT
Le Centre de recherche MINDIT (NaDI) développe depuis 2024 une expertise dans les systèmes d’information, un domaine de recherche à l’intersection de l’informatique et du management. Les travaux de MINDIT explorent le potentiel des nouvelles technologies (IA, internet des objets, réalité augmentée, big data…) dans l’objectif de répondre aux besoins concrets du monde de l’entreprise et des organisations publiques. MINDIT rassemble plusieurs académiques comme Corentin Burnay (directeur), Isabelle Linden, Stéphane Faulkner ou Annick Castiaux.
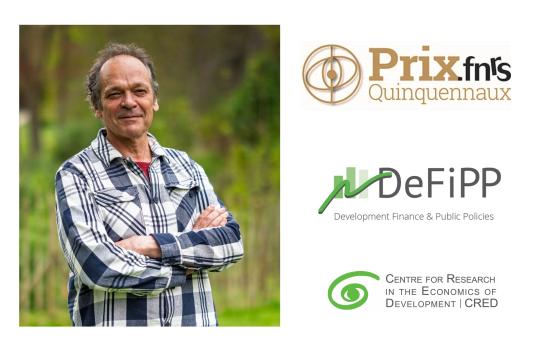
Un prestigieux prix FNRS en sciences sociales pour le Professeur Jean-Marie Baland
Un prestigieux prix FNRS en sciences sociales pour le Professeur Jean-Marie Baland
Le FNRS a décerné le Prix quinquennal Ernest-John Solvay en sciences sociales à Jean-Marie Baland, professeur au Département des sciences économiques de la Faculté EMCP de l’UNamur et cofondateur du Centre de Recherche en Economie du Développement (CRED) de l'Institut DeFiPP. Une reconnaissance majeure pour une carrière consacrée à l’étude des questions de pauvreté, d’institutions informelles et de développement durable.

Le Prix quinquennal Ernest-John Solvay, l’une des distinctions les plus prestigieuses du FNRS, a été attribué ce 24 novembre 2025 à Jean-Marie Baland, professeur au Département des sciences économiques de l’Université de Namur depuis 1991. Ce prix, décerné tous les cinq ans, récompense des chercheurs dont les travaux ont marqué leur discipline par leur originalité et leur impact.
« Jean-Marie Baland allie la rigueur théorique à des études de terrain menées dans des pays tels que l’Inde, le Népal, le Kenya et le Chili. Ses recherches abordent des questions essentielles comme le développement économique, la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement », souligne le jury du FNRS.
Une expertise reconnue internationalement
Spécialiste des pays les moins développés, Jean-Marie Baland a consacré ses travaux à l’analyse des institutions informelles, sujet pour lequel il a obtenu un ERC Advanced Grant en 2009. Ses recherches explorent également les déterminants de la déforestation, les conséquences de la pauvreté, et plus récemment, les causes de la mortalité infantile en Asie du Sud, ou la violence domestique.

La question centrale de mes recherches est de comprendre comment les groupes s’organisent pour la gestion de la prise de décision. Qui en profite ? Qui en est lésé ? Quels impacts cela produit ? J’ai abordé cette thématique sous diverses formes, avec des cas d’études très divers. Par exemple, au Kenya j’ai étudié comment au sein d’un bidonville, un groupement de femmes s’organisaient pour constituer une épargne collective leur permettant de subvenir à leurs besoins. Plus récemment, j’ai étudié le fonctionnement de la prise de décision au sein de couples en Europe. Aujourd’hui, je travaille avec ma collègue Catherine Guirkinger (Faculté EMCP, Département d’économie), sur la question de l’émancipation féminine et de son impact sur la violence domestique : permette-t-elle de la réduire ou de l’augmenter et dans les deux cas pourquoi ? Toutes ces questions sont analysées en s’appuyant sur une méthode interdisciplinaire, avec des approches issues de modèles statistiques, mathématiques et économiques, et des méthodes de sciences sociales comportant des enquêtes de terrain.
L’envie de comprendre le monde
Ce qui le motive depuis toujours ?
« L’envie de comprendre le monde. Ma motivation dans mes recherches a toujours été de produire de la connaissance avant de vouloir qu’elles aient un impact sociétal. L’utilité de la recherche est bien entendu importante, mais personnellement ce n’est pas cela qui me fait avancer. Le résultat de mes recherches est bien entendu régulièrement utilisé pour élaborer des politiques publiques par exemple. Mais cela n’est pas une fin en soi pour mon travail de chercheur », souligne-t-il.
La carrière académique de Jean-Marie Baland a été jalonnée de distinctions prestigieuses : Chaire Francqui (2008), Distinguished Fellow Award à Harvard (2007), membre de l’Academia Europaea (2012)… Autant de reconnaissances qui témoignent de son rayonnement scientifique.
L’UNamur mise en lumière
Mais l’une de ses plus grandes fiertés réside dans la création du centre de recherche en économie du développement (CRED) de l’UNamur, fondée avec le Professeur Jean-Philippe Platteau. Jean-Marie Baland est membre du Centre de recherche en économie du développement (CRED). Un centre aujourd’hui reconnu internationalement pour son expertise en économie du développement, microéconomie appliquée et économie de l’environnement, contribuant à des recherches à fort impact sociétal. « Le CRED compte aujourd’hui cinq académiques et une quinzaine de chercheurs », précise Jean-Marie Baland. L’économiste est aussi un des fondateurs du Master de spécialisation en économie du développement .
A la génération de futurs économistes, Jean-Marie Baland adresse ce souhait :
« Intéressez-vous à des domaines qui ont du sens pour vous ! Et travaillez en équipe, aussi avec des personnes qui pensent différemment de vous. Cette expérience d’interactions humaines a pour ma part été d’une très grande richesse », conclut-il.
Une cérémonie prestigieuse

Ces Prix prestigieux, attribués tous les cinq ans par le FNRS, ont été remis ce 24 novembre 2025 par le Roi Philippe à une chercheuse et cinq chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils confirment la reconnaissance internationale et couronnent la carrière exceptionnelle de ces scientifiques, dans toutes les disciplines. Les Excellentieprijzen du FWO, l’équivalent du FNRS en Flandre, ont également été décernés ce 24 novembre par Sa Majesté le Roi. Lors de cette cérémonie, Véronique Halloin, Secrétaire générale du FNRS, a félicité les lauréats, en remerciant les 42 membres des jurys internationaux mais aussi les mécènes qui rendent possible l’existence de ces Prix. Elle a également évoqué des « questions essentielles pour la recherche scientifique et la société tout entière », insistant sur la nécessité « de conserver le niveau de financement de la recherche fondamentale, de garder toute sa place à une recherche stratégique mais aussi aux sciences humaines et sociales. »
La presse en parle
- Regardez la vidéo de présentation de Jean-Marie Galand (c) The Content Company
- Ecoutez le podcast réalisé par DailyScience avec l’interview de Jean-Marie Baland.
- Téléchargez le communiqué de presse du FNRS.
- Téléchargez la brochure remise lors de la cérémonie
Événements
Séminaire "Methods" | Approches computationnelles du changement sémantique
"Methods" est une série de séminaires organisés par l'Institut Transitions de l'Université de Namur dans le but de favoriser la collaboration interdisciplinaire et l'échange de connaissances. Tous les séminaires se déroulent sous forme hybride.
Oratrice : Barbara McGilivray - Senior Lecturer in Digital and Computational Humanities at King's College London
Le changement sémantique, c'est-à-dire l'évolution du sens des mots au fil du temps, offre des informations cruciales sur les processus historiques, culturels et linguistiques. La langue agit comme un miroir des changements sociétaux, reflétant l'évolution des valeurs, des normes et des progrès technologiques. Comprendre comment le sens des mots évolue nous permet de retracer ces transformations et d'acquérir une compréhension plus approfondie de notre passé lointain et récent.
Ce séminaire explore la manière dont les méthodes computationnelles révolutionnent notre capacité à analyser le changement sémantique dans les textes historiques, relevant ainsi un défi majeur dans le domaine des humanités numériques. Si les méthodes computationnelles avancées nous permettent d'analyser de vastes ensembles de données et de mettre au jour des modèles auparavant inaccessibles, rares sont les algorithmes de traitement du langage naturel qui tiennent pleinement compte de la nature dynamique du langage, en particulier de la sémantique, qui est essentielle pour la recherche en sciences humaines. À mesure que les systèmes d'IA se développent pour mieux comprendre le contexte historique et la dynamique du langage, l'annotation et l'interprétation humaines restent essentielles pour saisir les nuances du langage et son contexte culturel.
Dans cette présentation, je montrerai comment les approches computationnelles et centrées sur l'humain peuvent être combinées efficacement pour examiner le changement sémantique et ses liens avec les développements culturels et technologiques. Je présenterai des exemples illustrant comment le changement sémantique peut être analysé à travers les dimensions temporelles, culturelles et textuelles.
Les séminaires "Methods"
Le séminaire sur les méthodes est une série de séminaires organisés à l'Université de Namur dans le but de favoriser la collaboration interdisciplinaire et l'échange de connaissances. Tous les séminaires se déroulent sous forme hybride.
Cette série de séminaires se concentre sur les approches méthodologiques avancées, en particulier dans les domaines du traitement du langage naturel (NLP), de l'intelligence artificielle (IA), de l'analyse vidéo et d'images, et de l'analyse multimodale.
Pour rester informé des détails des prochains séminaires, merci de vous inscrire à notre liste de diffusion ci-dessous.


